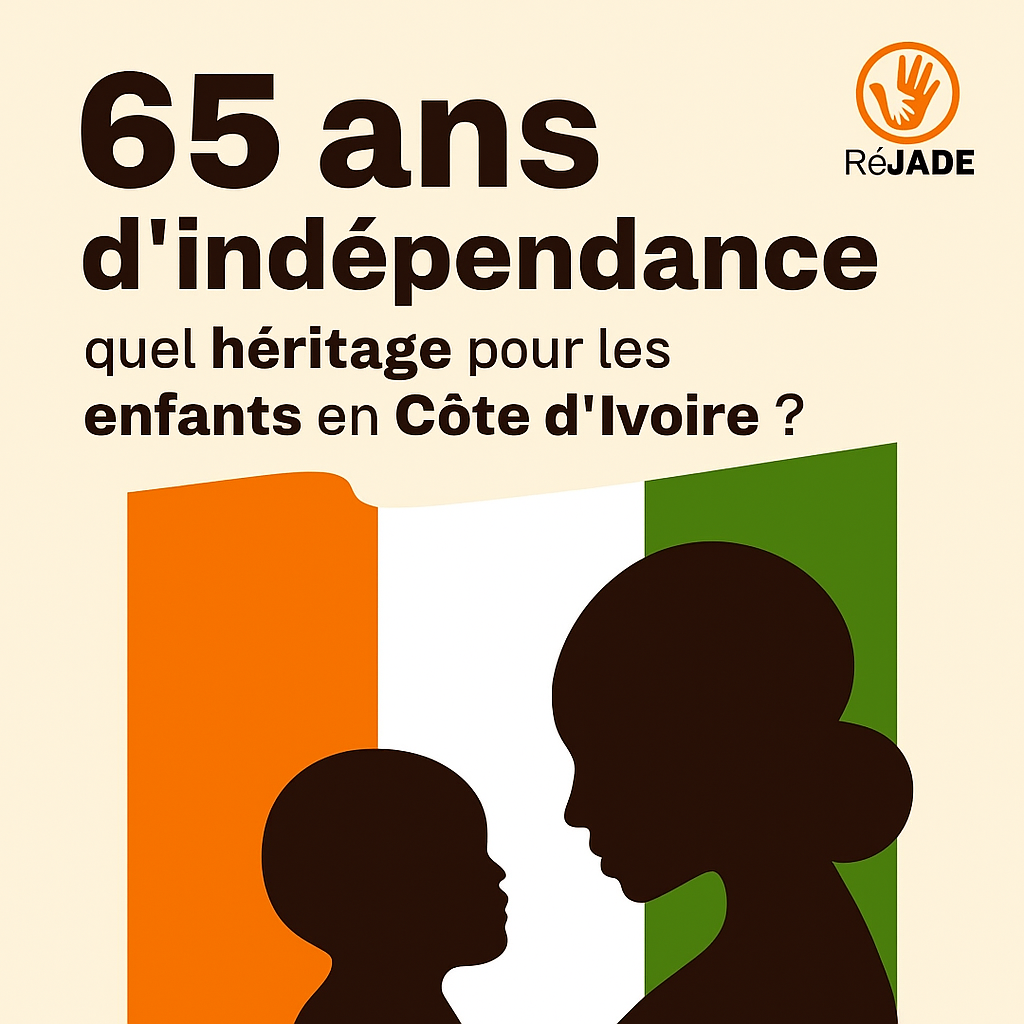Le 7 août 1960 marque une date charnière dans l’histoire contemporaine de la Côte d’Ivoire : celle de son accession à la souveraineté nationale. Ce moment, célébré chaque année avec faste, symbolise non seulement la rupture avec le colonialisme, mais également l’ouverture d’un cycle d’autodétermination politique, économique, sociale et culturelle. Pourtant, alors que l’on s’apprête à commémorer le 65ᵉ anniversaire de cette indépendance, une interrogation mérite d’être posée : quel a été l’impact réel de cette émancipation sur la condition des enfants ivoiriens ?
Les enfants, qui représentent près de 48 % de la population nationale selon les données les plus récentes du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2021), incarnent à la fois l’avenir et le miroir du présent. Or, durant plusieurs décennies, ils ont été relégués à la périphérie des priorités de l’État, invisibles dans les programmes économiques, marginalisés dans les politiques de santé, d’éducation ou de protection, et largement absents du discours politique dominant[1]. Ce n’est qu’à partir des années 1990, dans le sillage de la ratification par la Côte d’Ivoire de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (ratifiée en 1991), que les enfants ont commencé à être envisagés comme des sujets de droits, et non plus uniquement comme des objets de soins ou de devoirs parentaux[2].
Depuis cette prise de conscience juridique et éthique, des avancées indéniables ont été enregistrées, tant sur le plan normatif[3], que sur le plan institutionnel (avec la création d’organismes comme la Direction de la Protection de l’Enfant, ou le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants[4]). L’État ivoirien a également mis en œuvre plusieurs stratégies nationales en faveur de l’éducation, de la santé maternelle et infantile, ou encore de la lutte contre les violences basées sur le genre.
Mais ces efforts, s’ils sont notables, demeurent encore largement en deçà des besoins. Loin de constituer un levier d’égalité et d’émancipation, l’indépendance semble dans bien des cas avoir laissé les enfants en proie à de multiples vulnérabilités : travail précoce, mariages forcés, mortalité infantile élevée, exclusion scolaire, exploitation sexuelle, recrutement dans les conflits armés, insécurité juridique pour les enfants non déclarés à l’état civil, pour ne citer que quelques-unes des problématiques les plus préoccupantes[5].
Par ailleurs, la persistance des inégalités structurelles (rurales/urbaines, genre, pauvreté, accès aux services) complexifie davantage le processus d’effectivité des droits. L’indépendance politique de 1960 n’a pas systématiquement débouché sur une indépendance des corps et des droits pour les enfants. Si les institutions ont gagné en autonomie, l’enfant, lui, reste parfois prisonnier d’un système où ses droits fondamentaux sont subordonnés aux logiques économiques, culturelles, voire politiques[6].
En outre, l’évolution des contextes, marquée par les crises sociopolitiques (1999, 2002, 2010)[7], les mutations familiales, la montée des technologies, les migrations internes et transfrontalières impose de repenser aujourd’hui la place de l’enfant dans les politiques publiques. Dans une société ivoirienne en pleine transformation, où les tensions entre tradition et modernité affectent directement les parcours de vie des jeunes générations, la question des droits de l’enfant devient un test de sincérité démocratique autant qu’un baromètre du développement humain.
Cet article ambitionne ainsi d’analyser, avec rigueur et profondeur critique, les effets de l’indépendance sur la condition des enfants en Côte d’Ivoire. Il s’agira de dresser un bilan transversal, croisant les avancées juridiques et institutionnelles avec les réalités sociopolitiques, tout en mettant en lumière les défis persistants et les perspectives d’amélioration. La problématique centrale que nous étudierons est donc la suivante : dans quelle mesure les 64 années d’indépendance ont-elles favorisé l’effectivité des droits de l’enfant en Côte d’Ivoire ?
Pour répondre à cette interrogation, l’article sera structuré autour de deux grands axes : dans un premier temps, nous reviendrons sur les acquis de l’indépendance en matière de droits de l’enfant, notamment sur le plan normatif, institutionnel et politique ; dans un second temps, nous mettrons en lumière les insuffisances structurelles et les défis persistants, en insistant sur les failles systémiques, les résistances socioculturelles et les urgences de gouvernance.
Ce faisant, cet article ne se contentera pas d’un inventaire, mais se veut critique et prospectif, en proposant des recommandations concrètes pour faire de l’indépendance une réalité tangible dans la vie des enfants ivoiriens.
I. Des débuts fragiles : la difficile émergence des droits de l’enfant dans la Côte d’Ivoire postcoloniale (1960-1990)
Au sortir de la colonisation, la Côte d’Ivoire s’est engagée dans une dynamique de construction nationale fondée sur la stabilité politique et le développement économique. Cependant, cette orientation a longtemps laissé en marge les problématiques relatives à l’enfance. Durant les trois premières décennies de l’indépendance, les enfants de Côte d’Ivoire, tout en étant symboliquement célébrés comme “espoir de la nation”, sont demeurés invisibles dans les politiques publiques concrètes. Cette marginalisation institutionnelle et politique, héritée en grande partie du système colonial français, a conduit à une faible reconnaissance juridique et sociale de leurs droits. C’est seulement à partir des années 1990, avec la montée des revendications démocratiques et l’influence croissante du droit international des droits de l’homme, que l’enfant est progressivement sorti de l’ombre pour devenir un sujet de droit à part entière.
Dans cette première partie, il convient d’analyser les fondements de cette marginalisation initiale (A), avant d’examiner les premiers jalons d’un engagement institutionnel en faveur des droits de l’enfant (B). Il s’agit ainsi de comprendre comment le silence politique et juridique des premières décennies postcoloniales a cédé place à une reconnaissance progressive, encore balbutiante, mais annonciatrice de changements plus profonds.
A. L’héritage colonial et l’invisibilisation des enfants dans les politiques publiques
Le contexte politique et institutionnel dans lequel la Côte d’Ivoire accède à l’indépendance en 1960 est profondément marqué par l’héritage du système colonial français. Ce système, fondé sur la centralisation, la hiérarchie et l’assimilation, n’a jamais réellement conçu l’enfant africain comme un sujet politique ou juridique digne d’une protection spécifique. Dans les territoires d’outre‑mer, le droit applicable aux enfants relevait davantage de régimes coutumiers tolérés que d’un corpus normatif cohérent intégré dans le droit public ou privé colonial[8].
L’administration coloniale française en Afrique‑Occidentale Française (AOF) considérait la population autochtone, y compris les enfants, comme des sujets et non des citoyens. Par conséquent, les enfants africains étaient largement exclus du droit métropolitain de la famille, de l’éducation ou du travail. Le régime juridique était dual : les enfants des colons européens bénéficiaient des lois protectrices de la République, tandis que ceux des populations locales étaient soumis à des coutumes souvent patriarcales et inégalitaires[9]. Cette dichotomie a eu pour effet de priver la majorité des enfants ivoiriens de toute protection juridique structurée pendant des décennies.
À l’indépendance, cette structure institutionnelle a été reproduite presque à l’identique. L’État ivoirien nouvellement souverain, dirigé par le Président Félix Houphouët‑Boigny, a fait le choix d’un développement économique accéléré, souvent qualifié de “miracle ivoirien”[10], reposant sur une élite administrative restreinte et urbanisée. Dans ce schéma, les enfants ne figuraient pas comme une priorité politique. Le discours nationaliste les évoquait certes comme des symboles de l’avenir, mais sans leur reconnaître de droits propres ni définir une politique cohérente de l’enfance.
Sur le plan éducatif, le taux de scolarisation dans les années 1960 restait inférieur à 40 %, avec de fortes disparités entre les zones rurales et urbaines[11]. Les infrastructures éducatives étaient concentrées dans les grandes villes comme Abidjan, Bouaké ou Daloa, tandis que la majorité des enfants vivant dans les campagnes n’avaient accès ni à des écoles, ni à des enseignants formés. De surcroît, les filles étaient doublement désavantagées par un environnement patriarcal et des normes sociales discriminatoires, qui privilégiaient l’éducation des garçons[12].
En matière de santé, les politiques publiques des premières années de l’indépendance se concentraient davantage sur les grandes épidémies (paludisme, tuberculose, lèpre), sans que les enfants ne soient spécifiquement ciblés. Les programmes de vaccination restaient embryonnaires jusqu’à la fin des années 1970. Les structures hospitalières, mal équipées et inégalement réparties, limitaient l’accès aux soins pour les enfants, en particulier dans les zones rurales où les maternités étaient rares et souvent dépourvues de personnel qualifié[13].
Les enfants travailleurs, quant à eux, restaient totalement absents du radar institutionnel. Le phénomène du travail des enfants, largement répandu dans les plantations de cacao ou dans le secteur informel urbain, n’était pas réglementé, ni même dénoncé. Il était perçu comme un prolongement “naturel” de la contribution familiale et non comme une violation des droits de l’enfant[14]. L’absence de cadre législatif approprié reflétait un consensus social selon lequel les enfants devaient participer très tôt à l’économie familiale.
Enfin, les systèmes de protection sociale embryonnaires mis en place après l’indépendance (notamment les caisses d’allocations familiales ou de sécurité sociale) ne couvraient qu’une minorité de la population salariée formelle. La majorité des enfants ivoiriens, issus de familles agricoles ou du secteur informel, restaient donc hors du champ de toute politique de protection contre les risques sociaux ou les violences[15].
Ainsi, les trente premières années de l’indépendance ivoirienne ont-elles vu l’enfant évoluer dans un vide juridique, politique et social. Invisibilisé dans les textes comme dans les institutions, il a été relégué à un rôle passif, tributaire de la bonne volonté des adultes et de la conjoncture économique. Cette situation, prolongement direct de la logique coloniale, a durablement affecté la construction des droits de l’enfant en Côte d’Ivoire.
B. Les premières avancées institutionnelles : du silence politique à une reconnaissance formelle
À partir des années 1990, la Côte d’Ivoire connaît une lente mais réelle mutation dans sa perception institutionnelle de l’enfant, qui marque un tournant dans l’histoire des politiques publiques en faveur de l’enfance. Cette évolution est stimulée par une combinaison de facteurs, incluant l’internationalisation des droits de l’enfant, la pression des organisations internationales, et la prise de conscience progressive des vulnérabilités spécifiques auxquelles les enfants ivoiriens sont confrontés.
L’un des premiers signes concrets de reconnaissance de l’enfant comme sujet de politique publique en Côte d’Ivoire fut la création d’organismes administratifs dédiés. En 1993, le gouvernement ivoirien met en place la Direction de la Protection de l’Enfant (DPE), rattachée initialement au Ministère des Affaires Sociales. Cette direction avait pour mission la coordination des actions en faveur de l’enfance en situation difficile, notamment les enfants de la rue, les orphelins, et les enfants victimes de traite ou de violences familiales[16].
Cette institutionnalisation est consolidée par la création en 2003 du Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, qui permet d’intégrer les problématiques de l’enfance dans une vision plus globale des droits sociaux. Toutefois, malgré leur création, ces structures souffrent d’un manque de ressources financières, humaines et logistiques, ce qui limite fortement leur capacité d’intervention sur le terrain[17].
Parallèlement à cette structuration institutionnelle, la Côte d’Ivoire entreprend une réforme progressive de son cadre normatif. En matière d’éducation, la loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 institue l’obligation scolaire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Cette réforme s’inscrit dans une volonté de réduire les disparités éducatives héritées de la période post-coloniale et de favoriser une meilleure intégration des enfants dans la société moderne[18].
Sur le plan sanitaire, plusieurs programmes nationaux ont été mis en place, notamment le Programme élargi de vaccination (PEV), en partenariat avec l’OMS et l’UNICEF, qui a permis d’augmenter considérablement les taux de couverture vaccinale chez les enfants entre 1990 et 2010[19]. De plus, la Politique nationale de développement sanitaire (PNDS) adoptée en 1996 incluait un axe spécifique sur la santé maternelle et infantile, bien qu’elle n’ait pas été entièrement appliquée en raison de l’instabilité politique du début des années 2000[20].
La ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) par la Côte d’Ivoire en 1991 constitue un jalon majeur. Elle oblige l’État à adapter son droit interne et ses politiques publiques aux principes fondamentaux de la CDE, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie et au développement, la participation, et la non-discrimination[21].
Malgré ces avancées législatives et institutionnelles, les politiques publiques en faveur de l’enfant restent fragmentées et peu opérationnelles. Le Plan d’action national pour l’enfance (2002-2010), bien qu’ambitieux dans ses objectifs (réduction de la pauvreté infantile, amélioration de l’accès aux services sociaux de base), n’a pas été accompagné d’un cadre budgétaire solide ni d’un système efficace de suivi-évaluation[22].
La plupart des programmes destinés à l’enfance sont conçus dans un cadre projectif, souvent dicté par les bailleurs internationaux (UNICEF, Banque mondiale), sans réelle intégration dans une vision stratégique nationale. Par ailleurs, l’absence de données statistiques fiables et désagrégées sur la situation des enfants rend difficile toute planification rigoureuse[23].
La décentralisation, amorcée timidement dans les années 2000, n’a pas permis une appropriation locale des politiques de l’enfance, et les collectivités territoriales restent très faiblement impliquées dans la mise en œuvre des droits de l’enfant.
II. L’ancrage des droits de l’enfant dans le système juridique et politique ivoirien (1990-2010)
La décennie 1990 marque un tournant majeur dans l’histoire sociopolitique de la Côte d’Ivoire. Après trois décennies de gouvernance autoritaire et de centralisation politique, le pays s’engage dans une transition vers le pluralisme démocratique. Cette mutation institutionnelle, portée par des pressions internes et internationales, va profondément modifier le paysage des droits de l’homme, y compris ceux de l’enfant. En effet, dans un contexte de reconfiguration de l’ordre juridique et d’ouverture au droit international, la question des droits de l’enfant va progressivement s’imposer comme un axe structurant des réformes politiques. Cette dynamique s’articule autour de deux axes majeurs qui feront l’objet de cette partie : d’une part, le tournant de la démocratie et l’alignement sur les standards internationaux, marqué par l’adoption d’engagements juridiques forts et l’édification d’un cadre normatif adapté à l’enfant (A) ; d’autre part, les effets ambivalents de la crise politico-militaire, qui bien qu’ayant favorisé une certaine visibilité des vulnérabilités infantiles, ont aussi freiné les avancées et mis à mal les structures de protection existantes (B).
A. Le tournant de la démocratie et l’alignement sur les standards internationaux
La chute progressive du monopartisme en Côte d’Ivoire au début des années 1990 a ouvert un espace politique favorable à la redéfinition des priorités nationales, notamment en matière de droits humains. Dans ce contexte, les droits de l’enfant vont connaître une reconnaissance juridique et politique inédite, impulsée par une volonté d’alignement sur les normes internationales et par une pression croissante de la société civile nationale et des partenaires techniques et financiers.
Le 2 février 1991, la Côte d’Ivoire ratifie la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE), adoptée à New York le 20 novembre 1989. Ce texte, devenu l’un des plus universellement ratifiés dans l’histoire du droit international, reconnaît à l’enfant une personnalité juridique propre et garantit l’ensemble de ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels dans un cadre intégré et indivisible[24]. La ratification de la CDE marque un changement de paradigme pour l’État ivoirien, qui passe d’une conception paternaliste de la protection de l’enfant à une logique de reconnaissance de ses droits fondamentaux.
À travers cet acte, la Côte d’Ivoire s’engage à adopter toutes les mesures législatives, administratives et autres pour donner effet aux droits reconnus dans la Convention[25]. Cette ratification n’est pas qu’un geste symbolique : elle s’accompagne d’un travail progressif d’harmonisation du droit interne, de création d’instances de suivi et de participation à des processus d’évaluation périodique par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies[26].
Dans le prolongement de cette ratification, l’État ivoirien entame un chantier législatif ambitieux visant à adapter son arsenal juridique aux exigences de la CDE. Ce processus aboutira, en 2019, à l’adoption de la loi n°2019-573 du 26 juin 2019, fruit d’un long processus de consultation, bien qu’antérieur, des textes fondateurs ont commencé à voir le jour dès les années 1990.
Des réformes significatives sont mises en œuvre pour garantir le droit à l’éducation, à la santé, et à la protection contre toutes formes de violence. La loi n°95-696 du 7 septembre 1995 institue l’obligation scolaire pour tous les enfants de 6 à 16 ans[27]. Des textes spécifiques viennent également renforcer la lutte contre l’exploitation économique des enfants, notamment par le biais de la loi n°2010-272 du 30 septembre 2010 relative au travail des enfants[28]. Ces lois traduisent l’effort de construction d’un droit de l’enfance cohérent, fondé sur les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la non-discrimination et de la participation[29].
Un autre apport majeur de cette période réside dans la reconnaissance progressive de la participation des enfants à la vie publique. Cette participation, consacrée par l’article 12 de la CDE, prend plusieurs formes en Côte d’Ivoire, dont la plus emblématique est la création des Parlements d’enfants, initiés à la fin des années 1990 avec le soutien de l’UNICEF. Ces espaces permettent aux enfants de s’exprimer sur les politiques qui les concernent, de sensibiliser leurs pairs et de jouer un rôle d’interface avec les autorités locales et nationales[30].
Outre les parlements d’enfants, des consultations nationales sont organisées de façon périodique pour recueillir l’avis des enfants sur les grandes orientations politiques et législatives. Ce processus donne corps à une citoyenneté juvénile active, qui bien qu’encore inégalement répartie sur le territoire, ouvre la voie à une culture démocratique inclusive dès le plus jeune âge[31].
Par ailleurs,l’alignement de la Côte d’Ivoire sur les standards internationaux en matière de droits de l’enfant a été renforcé par la coopération avec des partenaires techniques et financiers tels que l’UNICEF, Save the Children, la Banque mondiale ou encore l’Union européenne. Ces acteurs ont joué un rôle crucial dans le financement, la conception et le suivi des programmes d’éducation, de santé infantile, de lutte contre la traite et le travail des enfants[32]. Ils ont également appuyé la création de mécanismes de coordination intersectoriels au sein de l’administration, contribuant à l’institutionnalisation des politiques de l’enfance.
Cependant, cette dynamique, aussi prometteuse soit-elle, s’est heurtée à plusieurs défis structurels : faible capacité des institutions publiques, fragmentation des politiques, déficit de données fiables et durable, manque de coordination entre les acteurs étatiques et non étatiques. Ces obstacles seront encore aggravés par la crise politico-militaire qui s’ouvre dès la fin des années 1990 et que nous analyserons dans la section suivante.
B. Les effets ambivalents de la crise politico-militaire sur les droits de l’enfant
Si la décennie 1990-2000 avait inauguré un tournant juridique et institutionnel en matière de droits de l’enfant, la période suivante marquée par l’instabilité politique et la guerre civile a mis à rude épreuve ces avancées. La crise politico-militaire survenue entre 2002 et 2011 en Côte d’Ivoire a profondément perturbé l’État de droit, fragilisé les institutions, et engendré un contexte sécuritaire délétère, dont les enfants ont été parmi les premières victimes. Ces bouleversements ont eu des effets ambivalents sur les droits de l’enfant : d’un côté, ils ont accéléré certaines formes de mobilisation humanitaire et d’attention internationale ; de l’autre, ils ont gravement compromis l’accès des enfants aux droits les plus fondamentaux, notamment l’éducation, la santé, la protection et la sécurité.
L’un des effets les plus visibles de la guerre civile fut la désorganisation quasi totale des services publics de base, notamment dans les zones dites « CNO » (Centre, Nord, Ouest), contrôlées par les forces rebelles. L’école, pilier de l’émancipation de l’enfant, a été directement ciblée par les affrontements. Selon l’UNICEF, entre 2002 et 2007, plus de 700 écoles ont été fermées, détruites ou utilisées à des fins militaires ou logistiques par les groupes armés, ce qui a empêché des centaines de milliers d’enfants d’accéder à l’éducation formelle[33]. Cette déscolarisation massive, particulièrement marquée chez les filles et les enfants vivant en milieu rural, a accentué les inégalités éducatives préexistantes et contribué à la reproduction de la pauvreté structurelle.
Dans le domaine de la santé, la situation n’était guère plus reluisante. Le démantèlement des infrastructures sanitaires, conjugué à la fuite des professionnels de santé et à la rupture des chaînes logistiques d’approvisionnement, a entraîné une hausse significative des taux de mortalité infantile et maternelle. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) relevait, dans son rapport de 2008, que le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans était passé de 103 à 121 pour 1 000 naissances vivantes entre 2000 et 2006[34]. De nombreuses vaccinations de routine ont été interrompues, exposant les enfants aux maladies évitables telles que la rougeole, la poliomyélite ou le tétanos.
Sur le plan sécuritaire, les enfants ont évolué dans un environnement de violence extrême, où les violations des droits humains étaient monnaie courante. Des cas de violences sexuelles, de détentions arbitraires, d’exécutions sommaires et de torture ont été documentés par la Commission nationale des droits de l’homme de Côte d’Ivoire et par des ONG internationales telles qu’Amnesty International[35]. Cette insécurité chronique a favorisé un climat de peur et d’angoisse, nuisible au développement psychologique et émotionnel des enfants, notamment dans les zones de conflit.
L’un des aspects les plus dramatiques de la guerre ivoirienne est sans doute l’enrôlement d’enfants dans les forces armées et les groupes rebelles. Malgré les engagements de la Côte d’Ivoire au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés ratifié en 2011, des centaines d’enfants ont été utilisés comme soldats, messagers, espions, porteurs ou esclaves sexuels pendant la guerre[36]. Ces enfants, souvent enlevés de force ou contraints par la pauvreté et la peur, ont été exposés à des violences extrêmes et à un endoctrinement qui laisse des séquelles durables.
Le phénomène des enfants déplacés internes représente un autre visage de cette crise. En raison des affrontements, des pillages et des massacres, plus d’un million de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile entre 2002 et 2011, dont une majorité d’enfants[37]. Ces enfants déplacés ont été privés de protection familiale, de scolarisation, de suivi médical et d’état civil. Leur situation de précarité les exposait à des formes d’exploitation diverses : travail forcé, traite, mendicité organisée, prostitution. L’absence de statistiques fiables et l’insuffisance des mécanismes de coordination humanitaire ont aggravé leur vulnérabilité.
Dans ce contexte de guerre prolongée, les structures nationales de protection de l’enfance se sont désagrégées. Les tribunaux pour mineurs, les brigades spécialisées de la police, les centres d’accueil pour enfants en danger, ainsi que les mécanismes de signalement des abus ont soit cessé de fonctionner, soit été relégués au second plan des priorités sécuritaires. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, pourtant compétent pour piloter les politiques de protection, a vu ses ressources considérablement réduites et ses capacités de coordination affaiblies.
Selon une évaluation conjointe de l’UNICEF et du gouvernement en 2010, 80 % des enfants en conflit avec la loi n’avaient pas accès à une assistance juridique et 65 % étaient détenus dans des établissements pour adultes, en violation flagrante de la législation nationale et internationale[38]. Cette absence de justice spécialisée et de prise en charge adaptée témoigne de l’effondrement de l’État de droit pour les enfants pendant la crise.
De plus, le système d’état civil, essentiel à la reconnaissance légale de l’enfant, a été paralysé dans de nombreuses régions. L’absence d’enregistrement à la naissance a entraîné une « invisibilité juridique » pour des milliers d’enfants, les privant de tout droit fondamental : accès à l’école, à la santé, à l’héritage, et même à la nationalité[39].
III. Consolidation inachevée : entre modernisation juridique et stagnations structurelles (2010-2024)
À l’horizon 2010, la Côte d’Ivoire, sortie de ses crises politico‑militaires, engagé sur la voie de la reconstruction, entend consolider les droits de l’enfant. Cette période marque l’émergence de réformes ambitieuses et de mécanismes de gouvernance innovants. Toutefois, ces avancées se heurtent à des résistances socioculturelles, à des disparités géographiques persistantes et à des obstacles institutionnels tenaces. Cette troisième partie propose une double analyse : d’abord, elle met en lumière les réformes structurelles et les innovations dans la gouvernance de l’enfance (A) ; puis elle examine les résistances sociales et les inégalités persistantes qui limitent l’effectivité des droits de l’enfant en Côte d’Ivoire (B).
A. Réformes structurelles et innovations dans la gouvernance de l’enfance
En 2011, le gouvernement ivoirien intensifie le rôle du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE), marquant une reconnaissance institutionnelle forte des enjeux liés à l’enfance. Cette structure ministérielle centralise la coordination des politiques publiques relatives à l’enfant, permet l’élaboration des stratégies nationales et offre une visibilité politique inédite à ces problématiques. Le MFFE joue un rôle pivot dans la mise en œuvre des engagements internationaux, la liaison avec les agences de l’ONU et la supervision des plans nationaux pour l’enfance.
Sous l’égide du MFFE, la Côte d’Ivoire adopte plusieurs programmes stratégiques, notamment le Plan national d’action pour les droits de l’enfant (PNADE) 2012-2016, suivi du PNADE 2017-2024, qui projette la Côte d’Ivoire vers des objectifs concrets de réduction des violences et d’accès élargi aux services. Ces plans couvrent des domaines variés : accès à l’éducation, santé maternelle et infantile, lutte contre le trafic d’enfants, et promotion de la participation des jeunes. Ils s’appuient sur des comités intersectoriels mobilisant les ministères de la justice, de la santé, de l’éducation, et de l’intérieur, ce qui constitue une avancée institutionnelle notable en matière de gouvernance.
De même, le Système intégré de protection de l’enfant (SIPE) constitue une innovation technique majeure. Élaboré à partir de 2015 avec l’appui de l’UNICEF et des partenaires internationaux, le SIPE vise à centraliser les données sur les enfants vulnérables, coordonner les contributions des services sociaux, des forces de l’ordre, et des ONG, et assurer un suivi individualisé des parcours de vie[41]. Lors des crises locales ou régionales, le SIPE permet un meilleur ciblage des interventions et une réponse plus rapide. Ce dispositif, bien que encore à renforcer, marque une rupture avec les anciens mécanismes fragmentés et non coordonnés.
B. Résistances sociales et inégalités persistantes
Malgré l’adoption de nombreux textes législatifs conformes aux standards internationaux, la Côte d’Ivoire continue de faire face à des résistances sociales profondes et à des inégalités structurelles qui entravent l’effectivité des droits de l’enfant. Ces résistances s’expriment à la fois dans les pratiques familiales, les représentations collectives, et les écarts socio-géographiques. Les lois, aussi ambitieuses soient-elles, peinent à transformer une réalité encore marquée par des logiques coutumières, des discriminations systémiques et une faible accessibilité des services publics dans certaines régions.
Bien que le Code civil ivoirien ait été réformé en 2019 pour fixer l’âge légal du mariage à 18 ans révolus pour les deux sexes, les mariages précoces demeurent une pratique courante dans de nombreuses régions du pays. Selon le rapport conjoint du MFFE et de l’UNICEF (2022), près de 27 % des filles ivoiriennes sont mariées avant l’âge de 18 ans, et ce taux atteint plus de 40 % dans certaines zones du Nord[42]. Ce phénomène s’explique par une combinaison de facteurs : pression sociale, pauvreté, poids des traditions, et insuffisance des dispositifs de signalement dans les zones reculées.
De même, les violences sexuelles à l’encontre des enfants, bien qu’encadrées par un arsenal répressif renforcé (Code pénal, loi sur les violences basées sur le genre), restent largement sous-déclarées. Des ONGs signalent que les cas enregistrés ne représentent qu’une fraction des abus subis, du fait du tabou social, de la crainte de la stigmatisation, et du manque de confiance envers la justice[43].
Quant au travail des enfants, il persiste dans plusieurs secteurs économiques, notamment l’agriculture (cacao, anacarde, coton), la vente ambulante, la mendicité et le petit artisanat. Un rapport de l’OIT et du BIT (2021) indique que plus de 1,3 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans sont concernés par des formes de travail inappropriées ou dangereuses en Côte d’Ivoire[44]. Cette situation est en contradiction avec la ratification par l’État de la Convention n° 138 sur l’âge minimum et de la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants.
La géographie du pays reste un facteur de différenciation significatif dans l’accès aux droits de l’enfant. Les inégalités entre les zones rurales et urbaines, ainsi qu’entre les régions du Nord et du Sud, sont marquées. Par exemple, selon l’enquête MICS 6 (2016-2021), le taux de scolarisation au primaire atteint 93 % à Abidjan, contre à peine 62 % dans certaines zones rurales du Nord[45]. Ces disparités s’expliquent par le manque d’infrastructures scolaires, l’éloignement géographique des services sociaux, et une faible densité de professionnels qualifiés dans les zones périphériques.
Par ailleurs, certains groupes d’enfants cumulent plusieurs formes de vulnérabilité : les enfants en situation de handicap, les enfants de la rue, ou encore les orphelins et enfants vulnérables (OEV). Ces catégories font l’objet de politiques spécifiques (comme le Programme National de Protection de l’Enfant Handicapé, PNP-EH), mais leur prise en charge reste partielle et souvent dépendante des ONG. La stigmatisation sociale et l’absence de mécanismes inclusifs dans le système scolaire renforcent leur marginalisation[46].
Les résistances ne sont pas uniquement matérielles. Elles s’enracinent aussi dans des conceptions traditionnelles de l’enfant, où celui-ci est souvent perçu comme un être passif, soumis à l’autorité parentale, et non comme un acteur de droit. Cela limite considérablement la mise en œuvre de certains programmes innovants, notamment en matière d’éducation sexuelle complète ou de participation citoyenne des enfants.
L’introduction de modules d’éducation sexuelle dans les programmes scolaires, portée par le MFFE et l’UNESCO, a suscité des polémiques dans plusieurs régions du pays. De nombreux parents et leaders religieux y voient une atteinte à la morale et à la culture locale, freinant ainsi son déploiement[47]. Pourtant, cette éducation est essentielle dans la prévention des grossesses précoces, des IST et des violences sexuelles.
De même, la promotion de la participation de l’enfant à la vie publique (via des parlements d’enfants, des comités jeunes, etc.) rencontre des obstacles dans les milieux ruraux, où l’expression des opinions des enfants est encore perçue comme une forme d’insubordination. Cela empêche une réelle appropriation des droits par les enfants eux-mêmes, pourtant clé pour l’ancrage durable des changements sociaux.
IV. Quelles perspectives pour faire des enfants les véritables héritiers de l’indépendance ?
Alors que la Côte d’Ivoire s’apprête à célébrer plus de six décennies d’indépendance, la question de l’enfance apparaît comme un marqueur décisif de l’avenir démocratique, économique et social du pays. En dépit des progrès juridiques, institutionnels et programmatiques réalisés depuis les années 1990, les défis restent considérables pour faire des enfants de véritables acteurs et bénéficiaires du développement. Dès lors, il devient impératif de s’interroger sur les perspectives à long terme. Cette réflexion s’articule autour de deux axes fondamentaux. D’une part, il s’agit de bâtir une politique publique holistique, inclusive et budgétairement soutenue, à la hauteur des ambitions de développement durable et de cohésion sociale (A). D’autre part, il convient de redéfinir profondément le regard que porte la société ivoirienne sur l’enfant, en favorisant une véritable culture des droits de l’enfant à tous les niveaux de la société (B).
A. Bâtir une politique publique holistique, inclusive et budgétairement soutenue
La construction d’une société protectrice des droits de l’enfant ne peut se faire sans une approche systémique, fondée sur une coordination transversale entre les différents ministères et niveaux de gouvernance, un financement pérenne, et une stratégie d’intervention localisée.
Tout d’abord, la transversalité intersectorielle constitue un impératif. Le bien-être de l’enfant ne relève pas du seul ressort du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant. Il s’agit d’un enjeu transversal qui concerne les ministères de l’Éducation nationale, de la Santé, de la Justice, de l’Intérieur, de la Sécurité, de l’Emploi, mais aussi ceux en charge du Budget, des Finances et de la Planification. Le Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS), présidé par la Première Dame, constitue un exemple prometteur de coordination institutionnelle. Toutefois, ce modèle devrait être élargi pour intégrer l’ensemble des thématiques liées à la protection intégrale de l’enfant, incluant l’éducation inclusive, la justice juvénile, la santé mentale, ou encore l’accès aux documents d’identité. Selon l’UNICEF (2023), « les actions de protection de l’enfant restent souvent sectorielles et cloisonnées, ce qui limite leur efficacité »[48].
Ensuite, l’enjeu budgétaire est tout aussi central. La Côte d’Ivoire a certes consenti des efforts budgétaires notables dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Toutefois, les allocations budgétaires spécifiques aux politiques de l’enfance restent insuffisamment identifiées et souvent faibles dans leur exécution. Selon le rapport 2023 sur les dépenses publiques sociales publié par le Ministère du Plan et du Développement, les crédits alloués à la protection sociale des enfants représentent moins de 0,8 % du PIB, bien en deçà des recommandations du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, qui préconise des budgets à deux chiffres pour l’enfance dans les pays en développement[49]. Il devient ainsi crucial de budgétiser spécifiquement les politiques de l’enfance, de renforcer les systèmes de suivi budgétaire participatif, et de rendre transparentes les allocations au niveau local, en impliquant la société civile, les élus locaux et les enfants eux-mêmes.
Par ailleurs, la gouvernance locale constitue une pierre angulaire d’une politique efficace. La décentralisation administrative devrait être mise à profit pour créer des cellules municipales et régionales de protection de l’enfance, capables de conduire des diagnostics territoriaux, de coordonner les acteurs locaux (services sociaux, écoles, structures de santé, ONG), et de mettre en œuvre des réponses adaptées. Des expériences pilotes menées à Bouaké, San Pedro ou Korhogo, dans le cadre du Système Intégré de Protection de l’Enfant (SIPE), ont démontré l’efficacité d’une gouvernance de proximité dotée de ressources et de compétences locales. Selon un rapport d’évaluation de l’UNICEF et du Ministère de la Famille (2022), « les mécanismes de coordination locale permettent une meilleure identification des enfants vulnérables et un traitement plus rapide des cas de maltraitance ou d’abandon »[50].
Enfin, cette gouvernance renouvelée suppose également une planification stratégique à moyen et long terme, ancrée dans une vision nationale partagée. Le Plan National de Développement (PND 2021-2025) met en avant le capital humain comme levier de croissance, mais la dimension « droits de l’enfant » y reste marginale. Une stratégie nationale unifiée pour l’enfance, articulée aux Objectifs de Développement Durable (ODD), s’avère urgente pour dépasser la logique de projets ponctuels et asseoir une politique d’État pérenne[51].
En somme, bâtir une politique publique holistique et inclusive pour les enfants ne relève pas d’un idéal abstrait. C’est une condition sine qua non pour construire une nation stable, juste et prospère. Investir dans l’enfance, c’est non seulement réparer les injustices du passé, mais surtout anticiper les fractures sociales de demain.
B. Redéfinir le regard sociétal porté sur l’enfant et promouvoir une culture des droits
La pleine effectivité des droits de l’enfant en Côte d’Ivoire ne saurait s’envisager sans une transformation profonde des représentations sociales relatives à l’enfance. Car au-delà des réformes juridiques et institutionnelles, les normes culturelles, religieuses et sociales continuent de peser lourdement sur la perception des enfants, souvent encore considérés comme des êtres passifs, sans voix ni volonté propre. Pour bâtir une société véritablement respectueuse des droits de l’enfant, il est impératif d’agir sur les mentalités, les pratiques communautaires, et les cadres éducatifs.
La première urgence est de mobiliser les leaders religieux, coutumiers et communautaires autour d’un pacte pour l’enfance. Ces figures d’autorité exercent une influence déterminante dans les communautés ivoiriennes, notamment en milieu rural, où leurs discours peuvent renforcer ou au contraire affaiblir les avancées législatives. Ainsi, l’implication des chefs traditionnels et des guides religieux dans des campagnes de sensibilisation, des ateliers de formation, ou des plaidoyers locaux peut contribuer à délégitimer des pratiques néfastes comme le mariage précoce ou les châtiments corporels, tout en favorisant l’acceptation de droits tels que la participation de l’enfant ou l’égalité filles-garçons[52]. De nombreux programmes internationaux, à l’instar de ceux de l’UNICEF ou de Save the Children, ont montré que lorsque ces leaders deviennent des ambassadeurs des droits de l’enfant, les résistances culturelles peuvent significativement s’atténuer[53].
Par ailleurs, il est fondamental d’intégrer de manière explicite et systématique les droits de l’enfant dans les curricula scolaires, de la maternelle à l’enseignement secondaire. Cela implique non seulement un enseignement théorique des droits humains adaptés à l’âge, mais aussi une pédagogie fondée sur le respect, la non-discrimination et l’écoute de l’enfant. Les écoles doivent devenir des lieux de modélisation des droits, où les enfants expérimentent au quotidien la démocratie scolaire, le dialogue et la citoyenneté[54]. Cette approche pédagogique est déjà promue par certaines ONG et institutions nationales, mais elle reste encore marginale dans le système éducatif ivoirien, souvent axé sur l’autorité verticale, la discipline rigide et les méthodes magistrales. Il serait donc nécessaire de former les enseignants à ces approches, en lien avec les instituts pédagogiques nationaux[55].
Enfin, il est crucial de soutenir l’autonomisation des enfants par la participation, l’éducation civique et l’accès à l’information numérique. L’expérience des parlements d’enfants ou des clubs d’enfants journalistes a montré que, lorsque des espaces d’expression leur sont offerts, les enfants peuvent s’affirmer comme des acteurs de changement, porteurs de solutions innovantes pour leurs communautés[56]. Il convient donc de pérenniser ces initiatives, de leur accorder des moyens techniques et financiers, et surtout de garantir qu’elles soient véritablement inclusives en intégrant les filles, les enfants en situation de handicap, et ceux vivant en milieu rural. Par ailleurs, l’accès à une information numérique sécurisée et éducative représente un levier incontournable dans un monde de plus en plus digitalisé. Il permet aux enfants de s’informer, de communiquer et de se former en dehors des canaux traditionnels. Il importe cependant de lutter contre la fracture numérique et les dangers du cyberespace, en accompagnant les enfants dans une éducation aux médias et à la citoyenneté numérique[57].
En somme, faire évoluer le regard sociétal sur l’enfant revient à reconnaître pleinement son humanité, sa dignité et sa capacité d’agir. C’est un travail de longue haleine, qui appelle une révolution silencieuse dans les foyers, les écoles, les lieux de culte et les médias. Mais c’est également un impératif si l’on souhaite construire une société ivoirienne où les enfants ne sont pas de simples héritiers biologiques de l’indépendance, mais bien les co-bâtisseurs éclairés de son avenir.
Conclusion
Soixante-cinq ans après son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire peut s’enorgueillir de plusieurs progrès notables en matière de protection de l’enfance. Des avancées législatives importantes, l’adoption de politiques publiques dédiées, la ratification d’instruments internationaux, la création d’organes spécialisés ou encore la multiplication des partenariats institutionnels témoignent d’une volonté étatique de faire de l’enfant une priorité de l’agenda national. De même, des évolutions dans la perception sociale de l’enfant, bien que lentes et inégales, indiquent que les lignes commencent à bouger.
Cependant, une lecture lucide et sans complaisance de la situation actuelle invite à tempérer cet optimisme. Car derrière les textes et les intentions louables, les défis structurels et sociétaux demeurent profonds. Les droits fondamentaux de milliers d’enfants restent quotidiennement bafoués, notamment en matière d’accès équitable à l’éducation, à la santé, à la justice, à l’identité civile ou à la protection contre les violences. À cela s’ajoutent des crises multiformes, économiques, politiques, sécuritaires qui ont contribué à fragiliser davantage les dispositifs de protection déjà limités.
L’indépendance d’un pays ne se mesure pas uniquement à sa souveraineté politique ou à sa croissance économique. Elle se jauge aussi et surtout à l’aune de sa capacité à garantir à chaque enfant un environnement propice à son développement intégral. Une nation véritablement indépendante est celle qui fait de ses enfants des héritiers non pas symboliques, mais réels, du projet républicain. À cet égard, il est permis d’affirmer que la Côte d’Ivoire n’a pas encore totalement relevé ce défi. Car une indépendance qui laisse en marge ses enfants les plus vulnérables reste inachevée, voire illusoire.
L’heure est donc venue d’un sursaut collectif. Il faut dépasser les approches fragmentées, les politiques conjoncturelles, les engagements ponctuels. Il faut penser et agir à l’échelle d’une génération, avec une vision claire, intégrée, inclusive et résolument tournée vers la transformation des mentalités autant que des structures. Cela suppose un leadership politique fort, une mobilisation citoyenne constante et une implication effective de tous les acteurs, État, collectivités territoriales, familles, communautés, société civile, partenaires techniques et financiers, médias, enfants eux-mêmes.
Il est indispensable de poser les bases d’un véritable « pacte national pour l’enfance ivoirienne », articulé autour de principes essentiels : la priorité budgétaire à l’enfance dans tous les secteurs, la territorialisation des politiques de protection, la lutte résolue contre les inégalités et les discriminations, la promotion d’une culture des droits dès le plus jeune âge, et la valorisation du rôle actif des enfants dans la société. Ce pacte ne peut être simplement moral ; il doit être institutionnalisé, chiffré, suivi, évalué.
Car il ne peut y avoir de développement durable, de paix véritable ni de prospérité partagée sans une attention soutenue et courageuse portée à l’enfance. Investir dans les enfants, c’est préparer une Côte d’Ivoire plus forte, plus juste et plus humaine. C’est honorer la promesse de l’indépendance. C’est, en somme, construire dès aujourd’hui la nation de demain.
Luc KOUASSI, Juriste Consultant Bilingue | Formateur | Bénévole humanitaire | Président du RéJADE.
denisjunior690@gmail.com / +225 07 795 704 35 / +90 539 115 55 28
[1] UNICEF Côte d’Ivoire, Analyse de la situation des enfants et des femmes en Côte d’Ivoire, 2020, p. 11.
[2] Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 44/25 du 20 novembre 1989, ratifiée par la Côte d’Ivoire le 4 février 1991.
[3] Loi n° 2019-573 du 26 juin 2019
[4] Comité national de surveillance, Rapport d’activités 2022.
[5] Human Rights Watch, Jeunes et exploités : le travail des enfants dans les plantations de cacao en Côte d’Ivoire, 2021.
[6] Fondation Friedrich Ebert – Côte d’Ivoire, Les droits de l’enfant en question : entre avancées légales et blocages culturels, 2019.
[7] Banque Mondiale, Côte d’Ivoire : Impact des crises sur les services sociaux de base, 2016.
[8] R. J. Mundt, Historical Dictionary of the Ivory Coast, livre consulté pour contexte colonial et droit coutumier africain (Cambridge University Press).
[9] T. Désalmand, Histoire de l’éducation en Côte d’Ivoire : de la Conférence de Brazzaville à 1984 (Cerap, 2004), décrit le dualisme juridique post-colonial
[10] R. M. Hecht, The Ivory Coast Economic ‘Miracle’ : historique économique du système Houphouët-Boigny (Journal of Modern African Studies, 1983)
[11] Refworld, 2004 Findings on the Worst Forms of Child Labor – Côte d’Ivoire, chiffres de scolarisation nettes et brutes en zone rurale vs urbaine
[12] Idem, démontrant disparités de genre dans l’accès à l’éducation primaire
[13] UNESCO & WHO, données historiques sur la couverture vaccinale et infrastructure sanitaire jusqu’aux années 1970 (voir paragraphes santé)
[14] ILO / Refworld, rapports 2002-2005 : travail infantile non réglementé, enfants dès 5 ans dans le cacao, absence de réglementation
[15] ILO / ACCEL AFRICA Côte d’Ivoire, système SOSTECI 2011-2020 montrant couverture limitée aux secteurs formels et invisibilisation des enfants ruraux
[16] Direction Générale de la Famille et de l’Enfant, Rapport d’activités annuelles 2005, Abidjan, Ministère de la Famille.
[17] UNICEF Côte d’Ivoire, Étude sur les capacités institutionnelles pour la protection de l’enfance, 2012. Disponible sur : https://www.unicef.org/cotedivoire
[18] République de Côte d’Ivoire, Loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 portant orientation de l’éducation nationale.
[19] Ministère de la Santé, Rapport annuel du Programme Élargi de Vaccination (PEV), 2010.
[20] Ministère de la Santé Publique, Politique nationale de développement sanitaire, 1996.
[21] Nations Unies, Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Côte d’Ivoire le 2 février 1991. Disponible sur : https://treaties.un.org
[22] Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Plan d’Action National pour l’Enfance 2002-2010, Abidjan.
[23] Banque mondiale, Système statistique national et protection de l’enfance en Côte d’Ivoire, 2014.
[24] Nations Unies, Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989. Disponible sur : https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
[25] Ibid., article 4.
[26] Comité des droits de l’enfant, Observations finales sur les rapports périodiques initiaux à la Côte d’Ivoire, CRC/C/15/Add.155, 2001
[27] Loi n°95-696 du 7 septembre 1995 portant loi d’orientation de l’éducation nationale.
[28] Loi n°2010-272 du 30 septembre 2010 relative au travail des enfants.
[29] UNICEF, L’intérêt supérieur de l’enfant : principes et application, New York, 2010.
[30] UNICEF Côte d’Ivoire, Bilan des Parlements des enfants de Côte d’Ivoire, Abidjan, 2014.
[31] Save the Children, La participation des enfants à la gouvernance locale en Afrique de l’Ouest, rapport régional, 2013.
[32] UNICEF, Plan de coopération Côte d’Ivoire – UNICEF 2008-2013, Abidjan, 2008.
[33] UNICEF. Côte d’Ivoire: L’éducation en péril dans les zones de conflit, Rapport d’évaluation, 2007, p. 4.
[34] Organisation mondiale de la santé. Statistiques sanitaires mondiales, OMS, 2008.
[35] Amnesty International. Côte d’Ivoire : Les enfants dans la tourmente, Rapport 2006.
[36] Human Rights Watch. My Heart is Cut: Children’s Rights Violations by Armed Forces in Côte d’Ivoire, HRW, 2005.
[37] HCR. Rapport sur les déplacements internes en Côte d’Ivoire, 2011.
[38] UNICEF & Gouvernement de Côte d’Ivoire. État des lieux du système de protection de l’enfant en Côte d’Ivoire, Abidjan, 2010, p. 37.
[39] Plan International. L’invisibilité juridique des enfants non enregistrés à la naissance, 2012.
[41] UNICEF Côte d’Ivoire & MFFE, Rapport d’évaluation du système intégré de protection de l’enfant (SIPE), Abidjan, 2019, disponible sur le site officiel du ministère.
[42] UNICEF Côte d’Ivoire, Situation des enfants et des femmes en Côte d’Ivoire, rapport 2022.
[43] CICEA, Statistiques annuelles sur les violences faites aux enfants, Abidjan, 2023.
[44] OIT & BIT, Le travail des enfants en Côte d’Ivoire – Rapport d’analyse, 2021.
[45] Ministère de l’Éducation nationale, Enquête MICS 6, 2016-2021.
[46] Handicap International, L’inclusion des enfants handicapés en Côte d’Ivoire : état des lieux et recommandations, 2020.
[47] UNESCO Abidjan, État des lieux de l’éducation sexuelle complète en Afrique de l’Ouest, 2021.
[48] UNICEF Côte d’Ivoire, État des lieux du système de protection de l’enfant, rapport technique, Abidjan, 2023, p. 11. Disponible sur : https://www.unicef.org/cotedivoire
[49] Ministère du Plan et du Développement (Côte d’Ivoire), Rapport sur les dépenses sociales et budgétaires ciblant l’enfant, Direction des Études Économiques, 2023, p. 18. Consultable via https://plan.gouv.ci
[50] Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant & UNICEF, Évaluation du SIPE – Rapport conjoint, Abidjan, 2022, p. 29. Accessible sur https://www.unicef.org/cotedivoire
[51] Plan National de Développement 2021-2025, document stratégique, Primature, Abidjan, 2021, p. 76. Téléchargeable via https://www.presidence.ci
[52] UNICEF Côte d’Ivoire, Plaidoyer communautaire pour l’abandon des mariages précoces, 2020.
[53] Save the Children, Working with Traditional and Religious Leaders to End Harmful Practices, 2019.
[54] Ministère de l’Éducation nationale, Guide pédagogique pour l’éducation aux droits humains, Abidjan, 2018.
[55] Institut Pédagogique National de l’Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP), Programme de formation initiale des enseignants à l’éducation citoyenne, 2021.
[56] Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), Rapport sur les pratiques de participation des enfants en Côte d’Ivoire, 2022.
[57] Internet Sans Crainte / Plan International, L’éducation au numérique en Afrique de l’Ouest : enjeux et stratégies, 2021.