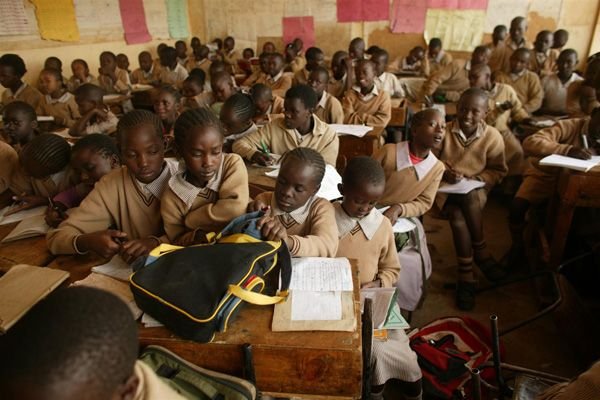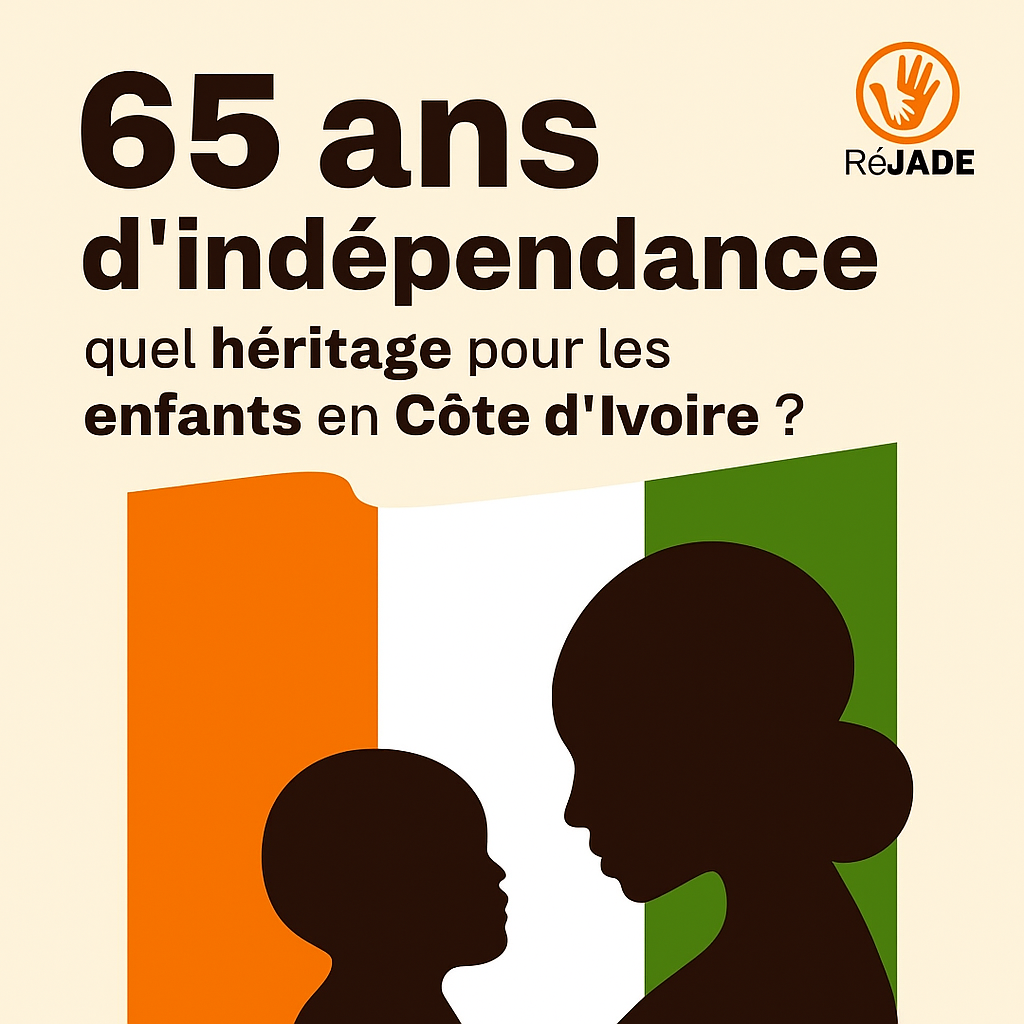La République démocratique du Congo (RDC) est confrontée à de nombreux défis socio-économiques, parmi lesquels la question des enfants de la rue occupe une place préoccupante. En effet, les enfants de la rue en RDC sont confrontés à des conditions de vie extrêmement difficiles, marquées par la pauvreté, la violence, l’exploitation et la marginalisation sociale. Cette réalité constitue une violation flagrante de leurs droits fondamentaux en tant qu’enfants et en tant qu’êtres humains, et soulève des questions cruciales en matière de droits de l’enfant et de droits de l’homme en Afrique.
La situation des enfants de la rue en RDC est complexe et multifactorielle. Elle est le résultat de divers facteurs, tels que la pauvreté généralisée, les conflits armés, les déplacements de population, les ruptures familiales, les abus et les négligences, ainsi que l’absence ou l’insuffisance de politiques sociales et de protection de l’enfance. Ces enfants se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes dans les rues des grandes villes congolaises, où ils sont exposés à de multiples dangers, notamment l’exploitation sexuelle, le trafic d’êtres humains, la toxicomanie et la criminalité.
Face à cette réalité alarmante, la question de l’accès à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants de la rue en RDC revêt une importance capitale. L’éducation et la santé sont des droits fondamentaux reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant, auxquels la RDC est partie. Cependant, pour les enfants de la rue, l’accès à ces droits est souvent compromis, voire inexistant, en raison des obstacles sociaux, économiques, culturels et institutionnels auxquels ils sont confrontés.
Cette recherche vise donc à explorer en profondeur la question de l’accès à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants de la rue en RDC, en examinant les défis et les opportunités qui se présentent dans ce contexte spécifique. En mettant en lumière les barrières à l’éducation et aux soins de santé, ainsi que les initiatives existantes visant à surmonter ces obstacles, cette étude contribuera à sensibiliser à l’importance de protéger les droits des enfants de la rue et à identifier des pistes d’action concrètes pour améliorer leur situation.
En outre, cette recherche revêt une importance particulière dans le contexte africain, où de nombreux pays sont confrontés à des défis similaires en matière de protection de l’enfance et de respect des droits de l’homme. En examinant le cas de la RDC, cette étude fournie des informations et des leçons apprises qui pourraient être utiles pour d’autres pays africains confrontés à des problématiques similaires.
Les enfants privés d’une éducation de qualité, à la fois inclusive et équitable, courent davantage les risques de la pauvreté, de la stigmatisation ou encore de la violence. Pour les enfants marginalisés, l’accès à l’éducation de qualité peut-être le facteur déterminant entre une vie d’exclusion et une vie participation active à la société. De l’éducation née la possibilité d’un accès juste et égal à un emploi décent, une rémunération suffisante, un moyen de subsistance durable et sain. Il faut signaler que la majorité des droits de l’enfant sont économiques, sociaux et culturels et leur réalisation dépend du système économique en place qui doit être fort.
Selon l’article 41 de la Constitution de la République Démocratique du Congo (RDC), « les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer la protection aux enfants en situation difficile ». Pourtant, dans les principales villes de la RDC, notamment Lubumbashi, de nombreux enfants se retrouvent dans les situations difficiles et sans aucune aide de la part du gouvernement. Certains de ces enfants se retrouvent à la rue après avoir été expulsés de leur maison tandis que d’autres ont volontairement décidé de quitter leur domicile familial. Quoi qu’il en soit, ils se battent tous pour survivre au quotidien dans les rues.
Ainsi, au cours de ses travaux sur l’enfance, l’Observatoire du Changement Urbain (OCU)[1] a mis en évidence l’ambivalence des autorités administratives et des policiers à l’égard des enfants de la rue [Rubbers, 2007]. Les autorités administratives tiennent un double discours à propos des enfants de la rue, qu’ils présentent tantôt comme des délinquants à réprimer et à discipliner, tantôt comme des victimes à sauver et à protéger. Quant aux policiers, ils peuvent agresser, maltraiter et voler ces enfants, tout comme ils peuvent les aider et collaborer avec eux.
Face à cette ambivalence, des pouvoirs publics envers les enfants de la rue, nous avons estime mener une étude sur le phénomène enfant des rues à l’épreuve de la politique économique afin de contribuer aux mécanismes de freinage et des sorties. Ainsi, dans la présente, nous allons analyser les différentes causes qui tirent les enfants dans les rues congolaises avec un accent particulier sur les causes socio-économiques dans la ville de Lubumbashi. Il est en réalité question de critiquer le système économique existant qui a facilité le déplacement des enfants dans les rues et avenues des principales villes du pays.
Ainsi, cette recherche s’inscrit dans une perspective à la fois nationale et continentale, visant à contribuer à la promotion des droits de l’enfant et des droits de l’homme en Afrique, en mettant en lumière une question cruciale et souvent négligée : l’accès à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants de la rue.
Sans être surpris d’une rareté des études assez coordonnées sur le phénomène enfant des rues à Lubumbashi, un nombre impressionnant d’études généralement financées par les structures manifestant un intérêt pour les enfants ont été faites et publiées sur les enfants des rues en RDC et dans le monde entier. Si la nôtre porte sur un questionnement de savoir Comment l’accès limité à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants de la rue en République démocratique du Congo constitue-t-il une violation des droits fondamentaux de l’ enfant et des droits de l’homme en Afrique; les études antérieures semblent reposer sur un autre questionnement, c’est notamment : Pourquoi ces enfants sont-ils dans la rue ? D’où viennent-ils ? Comment vivent-ils dans la rue ? Qu’est-ce qui les caractérise ?
Ainsi, la présente étude tente de contribuer aux moyens pouvant permettre d’arrêter l’expansion du phénomène et la sortie dans le système économique. Comme tout travail scientifique n’est nullement artificiel, et est inspiré de travaux des autres, nous allons, tout d’abord, en quelques lignes, donner ce qui a été dit par ceux d’avant nous ; ensuite une analyse de leurs propos, et enfin, ce que nous voulons dire.
IDZUMBUIR ASSOP Marie Joséphine dans son ouvrage, les lois de protection de l’enfant en république démocratique du Congo : difficultés des mises en œuvre, souligne que la protection de l’enfant et de la jeunesse reste une véritable préoccupation pour la plupart des pays du monde qui ont pris conscience que l’enfant et le jeune sont le devenir de toute une nation, que leur protection est une garantie pour la prévention de toutes sortes de déviation et pathologies sociales dont pourraient souffrir des adultes ; qu’elle est une assurance pour le progrès, le développement d’un pays et du monde. La république démocratique du Congo n’est pas restée ignorante de ces avantages significatifs. Elle s’implique sur cette voie en organisant et en posant un certains nombres d’actes au plan interne et international, pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes en difficulté[2].
Michel LEMAY a traité dans son ouvrage sur les conséquences de l’abandon sur le développement psychologique de l’enfant et dans ses relations personnelles et sociales. Pour cet auteur, les situations d’abandon qu’elles soient vécues au sein du milieu familial ou en institution, sont responsables de trouble gravé de l’attachement qui évolue dans le temps.
L’auteur montre également combien ces situations de perte précoce ou de faible investissement perturbent gravement la compétence parentale des sujet qui en ont souffert, créant véritables transmission de carence de génération en génération et enfin, il a analysé les interventions préventives et curatives qui sont à la disposition des experts pour diminuer la fréquence et les conséquences de discontinuités affectives au cours des premières années de la vie de l’enfant[3].
KASONGO LUKOJI, dans sa thèse portant sur l’essai de la construction d’un droit pénal des mineurs en R.D. Congo à la lumière du droit comparé, faisant une analyse minutieuse sur la nature de la déviance des mineurs en droit positif congolais, il part du constat selon lequel, prétendre construire un droit pénal des mineurs (DPM) en République démocratique du Congo (RDC) parait une œuvre doublement suicidaire qui appelle à surmonter d’innombrables difficultés liées à la fois à l’hétérogénéité de l’objet d’étude ainsi qu’à l’approche comparative dans laquelle veut s’inscrire ladite étude. Cet intitulé hérisserait, à coup sûr, dans l’esprit de tout lecteur, particulièrement congolais, plusieurs interrogations telles que : qu’en est-il du régime pénal applicable aux mineurs délinquants en RDC ? Existe-t-il un « Droit des mineurs » en RDC ? L’évolution des droits [subjectifs] des mineurs dans ce pays est-elle suffisante et homogène pour prétendre à la création d’un « Droit des mineurs » ? Comment prétendre « punir » puisque c’est à cela que renvoie le « droit pénal » des individus dépourvus de volonté éclairée ; et qui, dans le contexte africain, sont « au cœur d’une pauvreté et d’une insécurité routinières et persistantes »4, ou sont victimes d’un mépris caractérisé de leurs droits ? « Et, pourquoi pas les punir comme les adultes ? »
Il conclut en disant que cette approche est battue en brèche par la loi portant protection de l’enfant. S’il apparait clairement des dispositions légales précitées que la déviance est dorénavant incluse dans l’enfant en situation difficile, sa nature juridique est sujette à controverses[4].
BUKAKA BUNTANGU Jacqueline, dans sa thèse sur les enfants du dehors : étude de l’attraction de la rue, et des représentations de la famille et de la rue chez les enfants des rues à Kinshasa/RDC » part d’un constat fait lors de ses prestations auprès des enfants des rues à Kisantu et à Kinshasa : même les enfants issus de familles dont les ressources économiques sont plus ou moins suffisantes peuvent se retrouver dans la rue alors que bon nombre d’enfants issus des familles pauvres ne s’y retrouvent pas, en tout cas pas nécessairement. Si la situation économique et politique du pays doit certes être mise en cause, d’autres facteurs interfèrent donc aussi.
Sa problématique de départ gravitait autour de trois questions, à savoir : Pourquoi des enfants, en lieu et place de vivre en famille ou dans une institution d’accueil où ils peuvent bénéficier de soins et protections, optent-ils pour la vie dans la rue ? S’agit-il d’une situation voulue et acceptée, ou imposée et subie ? Comment ces enfants se représentent-ils la famille d’une part (comme environnement interne) et la rue d’autre part (prise d’abord dans un premier sens d’environnement externe) pour que cette dernière exerce un attrait sur eux et que certains la préfèrent à la vie en famille ? En dépit de toutes ses violences, la rue leur offre-t-elle des formes d’épanouissement et de liberté, dont il s’agit aussi de garder à l’esprit les limites, et quelles sont les ressources utilisées pour s’y adapter ou pour vaincre les difficultés ?
L’auteure vise principalement à explorer deux dimensions psychologiques du Phénomène des « enfants des rues » : les représentations que ces enfants ont d’eux-mêmes, de la famille et de la rue et l’identité personnelle et sociale. La rue, cet espace vécu comme vide et insécure par la société globale, peut en effet avoir du sens pour ces enfants.
Elle analyse leurs parcours de vie et ce qui les a amenés à quitter leur famille pour la rue et de comprendre comment la rue a pu devenir un lieu de vie, en dépit des défaillances familiales et sociétales, un espace où ces enfants sont devenus ou plutôt tentent sans cesse de devenir réellement auteurs et acteurs de leur vie.
Tout en mettant l’accent particulier sur les aspects spécifiques propres à chaque enfant des rues, elle opte pour une observation directe et participante, afin de mieux palper la réalité du phénomène, dans la diversité de ses formes et de donner la parole aux enfants qui le vivent, et en particulier à chacun de ceux que nous avons rencontrés.
Outre les enfants des rues eux-mêmes, l’auteure s’intéressée à des tiers, des personnes touchées et concernées par ce phénomène telles que : des parents, des frères et sœurs des enfants des rues, des enfants vivant en famille, mais qui connaissent des situations familiales conflictuelles et sont tentés par la vie de rue et des personnes ressources comme les travailleurs sociaux qui accueillent et accompagnent les enfants des rues. Avec ces personnes tierces et ressources, il réalise des entretiens semi-directifs. Ceux des enfants vivant en famille ont été reconstruits en récits de vie[5].
Alessandra D’ERRICO[6], dans sa thèse sur l’analyse socio-économique du phénomène des enfants de la rue à Dakar, au cours de son observation dans les rues de Dakar, il se pose une question principale question qui prend en charge ces enfants ? Comment l’Etat intervient pour régler ce phénomène ? Lors que les différentes collectivités s’engagent, par quels moyens elles apportent une véritable aide à ces enfants ?
Il démontre que l’Etat sénégalais a mis en place des changements dans la législation et qu’il a créé un centre et des structures administratives pour la prise en charge de ces enfants, mais il n’a pas encore atteint un niveau suffisant pour être en mesure d’éliminer ce phénomène, puisque la cause principale, la pauvreté, est encore très répandue. C’est en raison de cette incapacité de l’Etat à faire face à tous les enfants de la rue qu’il s’est développé un réseau dense d’organisations internationales et de collectivités privées.
Pour lui, il y a beaucoup d’enfants qui sont aidés à rentrer chez eux, à suivre un programme scolaire ou une formation professionnelle, mais le travail à faire reste encore beaucoup et il requiert encore du temps.
Florentin Azia Dimbu[7], dans son étude sur les Facteurs explicatifs du phénomène enfants de la rue à Kinshasa, il démontre que la presse scientifique atteste que les motifs à la base du phénomène sous examen sont multifactoriels. Ils vont de l’éclatement de la famille à l’industrialisation en passant par la sorcellerie, l’atomisation de la solidarité africaine. Dans le souci d’épingler ceux qui sont spécifiques à cette population d’études, 276 enfants de la rue de 4 à 18 ans, tout sexe confondu, ont été soumis à une entrevue non directive fondée sur le « récit de vie ».
Pour l’auteur, l’absence d’une véritable politique sociale au niveau gouvernemental et le manque d’engagement social dans le chef du Congolais seraient à la base de cette débâcle de la famille. Il est donc temps pour l’Etat congolais de prendre des mesures de protection des EDR à la hauteur du phénomène. Il lui appartient notamment, comme le préconise l’Unicef dans l’un de ses dépliants, « de créer un cadre social, politique et économique qui aide les parents à bien assumer leurs responsabilités familiales. Il doit, entre autres promouvoir une politique salariale permettant aux familles de mener une vie décente et de subvenir aux besoins de leurs enfants. Il doit assurer la gratuité de l’enseignement fondamental, élaborer et appliquer une politique nationale d’encadrement et de protection de l’enfant ». Il lui revient également de vulgariser et de faire respecter les instruments juridiques nationaux et internationaux de protection de l’enfant. C’est alors que leur progéniture mettrait un terme à la « théorie de coping 5 » pour se consacrer aux études.
L’engagement social, quant à lui, pourrait se traduire par la création d’une ASBL de protection des enfants, le soutien au gouvernement dans ses efforts de vulgarisation de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC, par exemple. Cela pourrait aussi se traduire par notre refus de voir les enfants qui font l’école buissonnière se planter devant notre parcelle.
Sébastien SHINDANO MPOYO-E-TAMBWE[8], le phénomène enfants de la rue et les mass media : considérations éthiques, tout au long de sa réflexion, il a montré que le phénomène enfants de la rue intéresse à plus haut niveau les Mass Média. Lorsqu’on lit la presse ou qu’on écoute la radio et même lorsqu’on regarde la télévision, on décèle deux attitudes fondamentales. D’un côté, on note un plaidoyer en faveur des enfants de la rue : le souci de scruter les racines de ce fléau et l’interpellation auprès des autorités pour une solution durable. De l’autre, peutêtre d’une manière inconsciente, les professionnels des médias contribuent à la perpétuation du phénomène. C’est la raison pour laquelle nous avons soutenu dès le départ que l’impact des Mass Média sur le phénomène enfants de la rue est à la fois positif et négatif.
Cet impact est positif dans la mesure où les Mass Média interpellent toute la communauté à prendre conscience du phénomène. Il est négatif dans la mesure où la médiatisation, parfois à outrance, de certaines rencontres des autorités suprêmes du pays avec cette classe sociale, favorise la propagande des détenteurs du pouvoir politique, économique ou financier. Par conséquent, elle est susceptible de créer des frustrations dans le chef des enfants convenablement encadrés par leurs familles, avec le risque de faire plonger ces derniers dans diverses perversions, en vertu du fait que les Mass Média influencent l’opinion et orientent certains comportements par imitation.
Mbwaka Mbwaka, dans sa thèse sur L’image de soi et anticipations imaginatives des rôles chez les enfants des rues de Kinshasa, réalisé en 2005, est motivé par la présence massive d’enfants dans les rues de Kinshasa. De nombreuses voix s’élèvent de partout à travers le monde en faveur d’un effort collectif visant à faire en sorte que les enfants des rues reprennent racine dans la vie sociale. Cette étude avait un triple but.
Connaître d’abord l’image de soi chez les enfants qui ont choisi la vie de la rue.
Ensuite, relever les stratégies utilisées par ces enfants face à la marginalisation dont ils sont victimes de la part de la société. Enfin, dégager leurs perspectives d’avenir et leurs aspirations. Le travail de Mbwaka a abouti aux résultats suivants : les enfants des rues ont une image de soi négative qui les dévalorise. Face au défi de la marginalisation, de nombreux enfants ont tendance à faire preuve de créativité. S’agissant de leurs aspirations et de leurs désirs d’un niveau élevé, ces enfants envisagent leur avenir avec beaucoup d’optimisme.
Mbwaka a conclu son étude par une réflexion : Rien de durable ne pourra être entrepris en faveur des enfants des rues, si nous ne nous mettons pas davantage à leur écoute et sans une prise en compte de leurs aspirations. Cette approche importante pourra nous permettre de mieux les aider et les soutenir, et pourquoi pas de négocier avec eux et même à plus forte raison, de prendre nos distances s’il le faut, dans cette reprise qui s’impose pour leur meilleur avenir (Mbwaka, 2005).
Kienge Kienge, sa thèse sur Le contrôle policier de la « délinquance » des jeunes à Kinshasa : une approche ethnographique en criminologie, réalisée en 2005, part d’un constat d’une présence massive d’enfants dans les carrefours des principales artères de la ville de Kinshasa et d’autres villes congolaises et africaines. Ces enfants sont communément appelés « shègues[9]», « phaseurs » ou encore « enfants sorciers » et généralement qualifiés de « délinquants ».
Pour l’auteur, depuis les années 1990, les expressions de justice pour mineurs ou de mineurs en conflit avec la loi ont supplanté celles de délinquance juvénile ou de jeunes délinquants. Mais curieusement, au cœur de l’administration de cette justice pour mineurs, se trouvent des préoccupations de prévention et de traitement de la délinquance juvénile.
L’auteur a opéré une déconstruction catégorielle de la « délinquance » généralement utilisée pour définir les situations impliquant les jeunes Kinois. Il a analysé le contrôle policier de ces situations et a examiné les diverses interactions auxquelles ce contrôle donne lieu, en appliquant à cet objet la grille criminologique de l’acteur social dans le champ de la criminologie, adaptée au contexte africain. Cette étude a présenté aussi bien les jeunes et les policiers que les autres protagonistes du contrôle des situations impliquant les jeunes comme des acteurs, c’est-à-dire des sujets porteurs d’un point de vue propre, et observe ainsi le jeu d’interactions entre eux comme un espace des points de vue, dont la confrontation laisse apparaître des représentations différentes et antagonistes de la délinquance des jeunes.
L’analyse de trois cas a débouché sur l’esquisse d’une théorie ancrée du contrôle Policier des situations-problèmes assumées par les jeunes. Elle montre que les situations définies comme constitutives de la délinquance se dissolvent dans une variété de situations problèmes aussi bien contextuelles que particulières aux jeunes de Kinshasa. Pour survivre, les jeunes se débrouillent, tout comme l’ensemble de la population adulte, face à des situations de misère, provoquées par la déliquescence de l’État en RDC. Il y a des transformations rapides que subit la société congolaise contemporaine dans une modernité globalisée.
Cette étude a aussi montré une police marquée par une misère institutionnelle et des policiers mobilisant toutes les ressources disponibles selon une logique de bricolage favorisant la capitalisation du pouvoir de contrôle de ces situations. La loi pénale apparaît, d’une part, comme une ressource symbolique, invoquée par les policiers sur un mode incantatoire. Et d’autre part, elle est comme une ressource instrumentale non seulement pour générer des recettes moyennant des amendes transactionnelles perçues par les policiers pour l’État et, souvent, pour leur propre survie.
Nous sommes convaincues que les auteurs dont l’analyse litanique vient d’être donnée ont le mérite d’être considérés comme pionniers pour nous. Mais disons qu’ils sont allés tous azimut en disant que le phénomène enfant des rues lorsqu’Ils présentent souvent la rue comme un milieu plein de dangers. Les enfants y habitent, s’adaptent, s’habituent et s’en sortent, parfois, pleins de vitalité et de maturité pour leur réintégration dans leurs familles respectives. Cependant, ceux qui ont abordé le phénomène sous l’angle juridique n’ont pas cessé de fustiger le fait que la pratique supplante les textes y relatifs en prenant pour repère et mesure idoine la mise en place des nouveaux textes ou l’effort dans l’applicabilité des textes. Pour eux, soit il y a absence des textes septiques à la question soit la difficulté d’application.
Par le fait, nous n’avons prétention aucune de minimiser les idées émises par eux en tant que pionniers ; mais, en nous inscrivant dans la même ligne de conduite, disons qu’eux ont abordé la question de manière générale sans en donner les spécificités. Notre point de démarcation se situe au niveau de la spécialité que nous renfermons en considérant les crises économiques répétées et l’introuvable intérêt supérieur de l’enfant dans la politique congolaise sont à la base du phénomène galopant des « enfants des rues » dans les principales villes du pays, y compris Lubumbashi. Il siéra de dire sans phrase que notre travail, loin d’être un simple exposé spéculatif, se fera de manière à ce que l’Etat repense un modèle économique basé sur la rente minière et l’endettement par un système économique diversifié lequel non seulement doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant mais aussi le considérant comme un acteur économique et non une progéniture de la rue. L’enfant n’est pas un déchet pour trouver placer dans la rue ni porter un tel sobriquet.
Les objectifs de cette recherche visent à approfondir la compréhension de la question de l’accès à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants de la rue en république démocratique du Congo (RDC), en mettant l’accent sur les enjeux relatifs aux droits de l’enfant et aux droits de l’homme en Afrique.
Cette recherche vise à identifier et à comprendre les multiples causes sous-jacentes à la marginalisation éducative et sanitaire des enfants de la rue en RDC. Il s’agit d’analyser les facteurs socio-économiques, culturels, politiques et institutionnels qui contribuent à perpétuer cette situation de vulnérabilité.
L’objectif est d’examiner les politiques gouvernementales, les programmes de développement et les initiatives de la société civile visant à améliorer l’accès des enfants de la rue à l’éducation et aux soins de santé en RDC. Il s’agit d’évaluer dans quelle mesure ces initiatives prennent en compte les besoins spécifiques des enfants de la rue et s’ils parviennent à produire des résultats tangibles.
Cette recherche vise à mettre en lumière les initiatives locales, nationales et internationales qui ont réussi à répondre aux besoins éducatifs et sanitaires des enfants de la rue en RDC. Il s’agit d’identifier les facteurs clés de succès et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de ces initiatives, afin d’en tirer des enseignements pour de futures interventions.
En résumé, les objectifs de cette recherche sont de contribuer à une meilleure compréhension des défis et des opportunités liées à l’accès à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants de la rue en RDC, et de formuler des recommandations pour promouvoir les droits de l’enfant et les droits de l’homme dans ce contexte spécifique.
La problématique constitue la partie la plus indispensable d’un travail scientifique, et peut être définie de plusieurs manières. La problématique se définit, selon MPALA MBABULA, comme étant la rubrique dans laquelle on articule un ensemble des problèmes (constat fait) qui engendrent des questions servant de fil conducteur du travail scientifique, et ce, en se référant aux concepts clés se trouvant dans le titre du travail ou le sujet retenu. Et de la problématique découle une question de recherche principale[10].
En effet, isolé et parfois innomé dans les siècles passés, en ce début du 21e siècle, le phénomène des « enfants des rues » est mondial ; les pays développés ou en voie de développement sont concernés. L’explosion démographique, la modernité, la disparité entre villes et campagnes, l’économie, ont fait de l’époque actuelle celle de tous les paradoxes.
Beaucoup plus c’est la crise économique et les politiques inadaptées des Etats qui vont faire inonder les rues, les avenues, les marchés de négoce les enfants abandonnés. Les Etats vont donner une progéniture à la rue. Ainsi, comme le note Edoardo Quaretta, les « enfants-sorciers » et les enfants de la rue font leur apparition à Lubumbashi et, plus généralement en République démocratique du Congo, après une période de crise socio– économique qui fut particulièrement prononcée au moment de la transition politique du pays (1990-1997).
A Lubumbashi, l’économie régionale katangaise se caractérisa par la faillite des entreprises publiques (Rubbers 2006), le déclin du commerce et une informalisation générale (Nkuku & Rémon 2006). L’instabilité économique provoqua une érosion de l’emploi et une chute des salaires. Les foyers de Lubumbashi éprouvèrent dès lors d’énormes difficultés à remplir les besoins primaires de ses membres (nourriture, soins de santé, écoles, vêtements). Il n’est pas rare, à partir de ce moment, que les enfants abandonnent l’école pour contribuer au budget de leur foyer (Petit 2003). L’apparition massive des enfants de la rue est, selon plusieurs observateurs, la conséquence de cette crise et du notable affaiblissement du modèle patriarcal de la famille urbaine (Dibwe dia Mwembu 2001).
L’érosion du tissu économique et la transformation des structures de la société depuis 1990 ont engendré l’émergence de nouveaux acteurs qui se sont imposés comme sujets institutionnels, au sens large du terme, afin d’exercer un pouvoir normatif et disciplinaire sur l’enfance et la famille.
Les rues et les marchés de la ville vont enfin connaitre une explosion des enfants abandonnés aux origines diverses. Peu de gens les regardent, leur sourient, les écoutent où leur parlent. Beaucoup de ceux qui les ont engendrés ne veulent plus les voir, passent avec indifférence et n’osent pas les approcher. Ces enfants sont en fait considérés comme des indésirables, des êtres dangereux, nuisibles, des déchets pour la poubelle qu’il faudra vite évacuer ou vider, car ils sentent.
Ainsi, la problématique soulevée par la question de l’accès à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants de la rue en République démocratique du Congo (RDC) est complexe et soulève plusieurs questions fondamentales nécessitant une analyse approfondie.
Tout d’abord, la situation des enfants de la rue en RDC met en évidence un dilemme majeur entre les aspirations des enfants à bénéficier de leurs droits fondamentaux, tels que le droit à l’éducation et à la santé, et les obstacles structurels qui entravent la réalisation de ces droits. Ces obstacles comprennent la pauvreté, la marginalisation sociale, les violences urbaines, le manque d’infrastructures éducatives et sanitaires adaptées, ainsi que les lacunes dans les politiques publiques de protection de l’enfance.
En outre, la problématique de l’accès à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants de la rue en RDC soulève des questions sur la responsabilité des acteurs étatiques et non étatiques dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. Il est essentiel d’analyser les politiques gouvernementales en matière d’éducation et de santé, ainsi que les programmes de développement et d’assistance sociale, pour évaluer dans quelle mesure ils prennent en compte les besoins spécifiques des enfants de la rue et s’ils parviennent à garantir leur accès effectif à ces services essentiels.
Par ailleurs, la problématique de l’accès à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants de la rue en RDC soulèvent des questions sur les approches et les pratiques innovantes pouvant contribuer à améliorer la situation de ces enfants. Il convient d’examiner les initiatives locales, nationales et internationales visant à répondre aux besoins éducatifs et sanitaires des enfants de la rue, ainsi que les défis rencontrés dans la mise en œuvre de ces initiatives et les leçons apprises.
Enfin, la problématique de l’accès à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants de la rue en RDC nécessite une réflexion plus large sur les enjeux de justice sociale, de droits de l’homme et de développement humain dans le contexte africain. Il s’agit d’analyser les liens entre la marginalisation des enfants de la rue et les inégalités structurelles qui persistent dans la société congolaise, ainsi que les implications de cette marginalisation pour la cohésion sociale et le développement durable du pays.
De cela, après une réflexion approfondie, notre question de départ se présente de manière suivante :
- Comment l’accès limité à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants de la rue en République démocratique du Congo constitue-t-il une violation des droits fondamentaux de l’enfant et des droits de l’homme en Afrique ?
S’inscrivant dans une démarche inductive, la compréhension de cette question de recherche s’accompagne d’une autre série de sous questions qui constituent donc notre ancrage théorique.
Il s’agit des sous questions suivantes :
- Quelles sont les mécanismes de freinage du phénomène enfant de la Rue ?
- Quelles sont les mécanismes de sorties du phénomène enfant de la Rue ?
Ces questions doivent faire l’objet d’une analyse minutieuse en termes d’hypothèse.
Tout travail scientifique doit avoir cette partie qui n’est constituée que de différentes réponses provisoires données aux questions posées dans la problématique. Louis MPALA MBABULA définit l’hypothèse de la manière suivante : « c’est une réponse provisoire donnée aux questions de la problématique. Elle servira de fil conducteur, car elle est une conjecture ou une proposition de réponse à la question posée ».
Dans ce sens que l’auteur évoque l’objet et la valeur de l’hypothèse, notons que l’accès limité à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants de la rue en République démocratique du Congo (RDC) constitue une violation flagrante des droits fondamentaux de l’enfant et des droits de l’homme en Afrique. Cette situation présente des implications graves et multidimensionnelles qui sapent les principes fondamentaux des droits de l’homme et mettent en péril la vie des enfants.
Tout d’abord, l’éducation est universellement reconnue comme un droit fondamental de tout enfant. C’est un élément essentiel pour garantir le développement individuel, l’autonomie et la participation à la société. En privant les enfants des rues de l’accès à l’éducation, la RDC viole les principes énoncés dans des instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant.
Ces enfants sont souvent exclus du système éducatif formel en raison de leur situation de vie instable, de la stigmatisation sociale et de l’absence de structures gouvernementales adaptées à leurs besoins spécifiques. Cette exclusion les condamne à un cercle vicieux de marginalisation et de pauvreté, limitant ainsi leurs opportunités futures et compromettant leur capacité à réaliser leur plein potentiel.
De même, l’accès limité aux soins de santé pour les enfants des rues en RDC constitue une grave violation des droits de l’homme. Les enfants des rues sont confrontés à des conditions de vie extrêmement précaires, exposés à des risques de maladies, de malnutrition et de blessures non traitées. L’absence d’accès à des soins de santé adéquats aggrave ces problèmes de santé, compromettant leur bien-être physique et émotionnel. En ne garantissant pas leur accès aux services de santé de base, la RDC viole les principes de non-discrimination et de droit à la santé, énoncés dans des instruments internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cultes.
En outre, il est important de reconnaître que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables et ont besoin d’une protection spéciale de la part de l’État et de la société. Cependant, en RDC, ces enfants sont souvent laissés à eux-mêmes, exposés à toutes sortes de dangers, y compris la violence, l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains. Leur exclusion des services sociaux de base et leur marginalisation sociale exacerbent leur vulnérabilité et compromettent leur sécurité.
L’accès limité à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants des rues en République démocratique du Congo constitue une violation grave et systématique des droits fondamentaux de l’enfant et des droits de l’homme en Afrique. Il est impératif que le gouvernement de la RDC prenne des mesures immédiates et efficaces pour remédier à cette situation, en garantissant que tous les enfants, quel que soit leur statut social ou leur situation de vie, aient accès à une éducation de qualité et à des soins de santé adéquats.
L’observation même peu attentionnée de la société congolaise met en lumière la déviance et la recrudescence de la délinquance parmi les enfants des rues. En sondant les facteurs qui poussent à ce comportement, on évoque au premier chef la dégradation croissante de l’économie congolaise qui constitue la porte la plus large pour le départ dans les rues. C’est pourquoi il est sans nul doute que la politique économique peut impacter positivement le phénomène galopant des enfants des rues dans les principales villes congolaises et à Lubumbashi, lorsqu’elle prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et va à considérer ce dernier dans une certaine mesure comme un acteur économique[11] et non un déchet que les services de sécurité doivent orienter dans des endroits où son intérêt supérieur est mis en cause.
Dans le temps
En effet, dans le cadre de ce travail d’ampleur considérable, nous allons parler du phénomène au cours de la période allant de 2009 à 2024 ; soit une période de quatorze ans.
Ce choix n’est pas hasardeux, mais se justifie par le fait qu’en cette période de ma mise en place de la troisième république, le pays devrait être gouverné autrement avec des nouvelles politiques à un impact réel sur le développement socioéconomique au pays. C’est dans lancé que le domaine de l’enfant a été prise au sérieux avec la promulgation de la loi portant protection de l’enfant le 10 janvier 2010, le Décret n° 09/38 du 10 octobre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de lutte contre les violences faites à la Femme et à la Jeune et Petite Fille et bien d’autres institutions.
La date de 2024 est prise de l’évolution rapide du phénomène et les différentes mesures qui ont été prises notamment l’opération kanyama kasese à Lubumbashi.
Cette délimitation temporelle nous permettra aussi d’aborder la question des enfants de la rue dans l’espace.
Les investigations à mener ne peuvent avoir de sens que si elles sont faites dans un champ bien défini, c’est-à-dire le territoire sur lequel on fait les analyses. Dans cette étude, notre champ de recherche, est l’Afrique en générale et les principales villes de la RDC, plus particulièrement. Dans ce cas, nous serons en mesure de nous rendre, sera-ce possible, compte de ce qui se passe réellement. De manière schématique, ce point nous renvoie clairement à la détermination de la matière sur laquelle nous allons nous mouvoir.
Dans la mesure où il est nécessaire que chaque travail scientifique ait un plan, nous nous faisons ainsi violence de faire sommairement la subdivision du travail.
[1] L’Observatoire du Changement Urbain est une structure de recherche qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre l’Université de Lubumbashi et les Universités francophones de Belgique. Créé à l’initiative de P. Petit et de
J.-B. Kakoma en 2000, ce centre a, depuis cette date, mené des recherches sur différents aspects de la vie lushoise.
[2] IDZUMBUIR ASSOP Marie Joséphine, Les lois de protection de l’enfant en république démocratique du Congo, Analyse critique et perceptive, CEDESURK, Kinshasa, 2013, p.15.
[3] MICHEL L. les conséquences de l’abandon sur le développement psychosocial et dans ses relations personnels et sociales, édition 25 RDUS, Paris, 1994, p1.
[4] Ghislain KASONGO LUKOJI, « Essai sur la construction d’un droit pénal des mineurs en R.D. Congo à la lumière du droit comparé », Thèse de Doctorat en Droit, Université d’Aix-Marseille, 2017, p. 149 inédit.
[5] BUKAKA BUNTANGU, Jacqueline « Les enfants du dehors : étude de l’attraction de la rue, et des représentations de la famille et de la rue chez les enfants des rues à Kinshasa/RDC » UNIVERSITÉ CATHOLIQUE
DE LOUVAIN Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation Septembre 2013
[6] Alessandra D’ERRICO, analyse socio-économique du phénomène des enfants de la rue à Dakar, université de turin, Master 2 en sociologie, Année 2013/2014
[7] AZIA DIMBU Florentin, Facteurs explicatifs du phénomène enfants de la rue à Kinshasa, Revue de l’Association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Éducation www.la-recherche-eneducation.org Nº 7 (2012), pp. 17-30
[8] Sébastien SHINDANO MPOYO-E-TAMBWE, Le phénomène enfants de la rue et les mass media :Considérations éthiques, Revue des Cultures Africaines,
[9] Le mot shègue peut s’écrire shège.
[10] Louis MPALA MBABULA, Pour vous chercheur, directives pour rédiger un travail scientifique suivi de recherches sur internet, 8e éd., Ed. MPALA, Lubumbashi 2017, p. 90.
[11] L’enfant était plutôt une richesse économique, car considéré comme une main-d’œuvre facile et moins coûteuse en accompagnant ses parents aux champs et plus tard en prenant soin d’eux dans leur vieillesse.
REFERENCES LEGALES BIBLIOGRAPHIQUES
I. TEXTES DES LOIS
A. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
- Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 26 juin 1973 (entrée en vigueur : 19 juin 1976) ;
- Convention des nations unies relative aux droits de l’enfant adoptée par l’assemblée générale de l’organisation des nations unies à new york, le 20 novembre 1989.
- Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 17 juin 1999 (entrée en vigueur : 19 novembre 2000) ;
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 RTNU 171 (entrée en vigueur: 23 mars 1976).
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 RTNU 3 (entrée en vigueur : 3 janvier 1976).
- Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
- Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990 ;
- Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990 ;
- Convention relative aux droits de l’enfant (1989) AG ONU ;
- Convention relative aux droits de l’enfant, 20 Novembre 1989, 1577 RTNU 3 (entrée en vigueur : 2 septembre 1990).
- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
- Déclaration des droits de l’enfant, Rés AG 1386 (XIV), Doc off AG NU, 14e sess, Doc NU (1959).
- Déclaration universelle des droits de l’Homme, Rés AG 217(111), Doc off AG NU, 3e sess, supp n°13, Doc NU A/810 (1948)
- Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale : Administration de la justice pour mineurs (1997), ECOSOC ;
- Pacte sur la Paix, la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs.
- Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (1990), AG ONU ;
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000), AG ONU, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants (2002), AG ONU ;
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications individuelles (2011), AG ONU.
- Règles de Beijing du 29 novembre 1985
- Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (1990), AG ONU ;
- Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (1985), AG ONU ;
B. Instruments juridiques nationaux
- Constitution du 18 février 2006, in journal officiel de la RDC 47eme année, numéro spécial, février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi N°11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles.
- Loi du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n° 87-010 du 1 er août 1987 portant Code de la famille
- Code du travail
- Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in journal officiel, 50éme année, numéro spécial, 25 mai 2009.
- Loi n° 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016 par la Loi n°16-008 du 15 Juillet 2016 portant Code de la famille,
- Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;
- Décret de 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour ;
- Décret n° 09/38 du 10 octobre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de lutte contre les violences faites à la Femme et à la Jeune et Petite Fille
- Ordonnance n°14/021 du 08 juillet 2014 portant nomination d’un Représentant personnel du Chef de l’Etat en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants ;
- Arrêté interministériel n°490/CAB/MIN/J&DH/2010 et n°011CAB/MIN/.GEFAE du 29 décembre 2010 portant composition, organisation et fonctionnement du Comité de médiation en matière de justice pour mineurs.
- Arrêté interministériel n°490/CAB/MIN/J&DH/2010 et n°011CAB/MIN/.GEFAE du 29 décembre 2010 portant composition, organisation et fonctionnement du Comité de médiation en matière de justice pour mineurs.
II. JURISPRUDENCES
- C.S.J., 31 août 1984, en cause MP c/KASHWANTALE et consorts, BA, 1980-1984 ;
- Boma, 18 sept. 1905 et 28 mars 1905, Jur. Et., II 24 ;
- TPE/BKV,Décision n°920/017, 30 mars 2017, Ministère public et partie civile contre Y.
- TRIPAIX/Bukavu, 12 décembre 2018, en cause BISIMWA JEAN VINCENT DE PAUL, jugement RC 1543/IX »,
- Tribunal pour enfants, Décision n° RECL 920/017, 30 mars 2017, X contre Y
III. OUVRAGES
- BONNY CYZUNG, Les infractions et leur répression en Droit congolais : catalogue des infractions, s.é., s.d.;
- G. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, Tome II, 2ème édition, L.G.D.J., Paris, 1985 ;
- G. MINEUR, Commentaire du code pénal congolais,
- GRUA F., Méthodes des études de Droit, DALLOZ, Paris 2006 ;
- J. TREPANIER et F. TULKENS, Délinquance et protection de la jeunes, De Boeck, Bruxelles, 1995,
- KIFWABALA TEKILAZAYA J.P., Droit civil, les biens, Tome I, PUL, 2004 ;
- LUZOLO BAMBI Lessa E. et BAYONA-ba-MEYA, Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2011 ;
- MPALA MBABULA Louis, Pour vous chercheur, directives pour rédiger un travail scientifique suivi de recherches sur internet, 8e éd., éd. MPALA, Lubumbashi 2017 ;
- MULUMBATI NGASHA Adrien, Manuel de sociologie générale, éd. AFRICA, Medias Paul, Lubumbashi, 2010 ;
- NGOTO Ngoie NGALINGA, Guide de protection de l’enfant, Editions Droit et Sociétés, Kinshasa, 2017 ;
- NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, 2ème édition, Kinshasa, 2007 ;
- PIERRE Larousse, Dictionnaire Larousse, édition librairie, Paris, 1971 ;
- STEFANI et LEVASSEUR, Précis de droit pénal général, éd. Dalloz, 17ème éd., Paris, 2000 ;
- VIGNOLES P., La dissertation philosophique au bac, s.é., Paris 1985 ;
- XAVIER PIN, Droit pénal général, édition Dalloz, Paris, 2014
- ZERMATTEN (J.), « Les instruments internationaux en justice juvénile », in Justice juvénile : les fondamentaux, Institut International des droits de l’enfant, Suisse, 2016, p
IV. OUVRAGES SPECIFIQUES
- KIBWENGE, F., Les enfants sorciers en Afrique. Perspectives théologiques. Paris : L’harmattan, 2008).
- GOFF, J.-F. L’enfant, parent de ses parents. Parentification et thérapie familiale. Paris : L’Harmattan, 2000.
- LEMAY, M. L’éclosion psychique de l’être humain. La naissance du sentiment d’identité chez l’enfant. Paris : Fleurus, 1983
- LEMAY, M., J’ai mal à ma mère. Paris : Fleurus, 2001
- LUCCHINI, R. (1993). L’enfant de la rue. Identité, sociabilité, drogue, Paris : Droz.
- KLEIN, M., Essais de psychanalyse. Paris : Payot, 1968
- KOUDOU KESSIE, Éducation et développement moral de l’enfant et de l’adolescent africains. Paris : l’Harmattan, 1996.
- LUTTE, G., Les enfants de la rue au Guatemala : princesses et rêveurs. Paris : L’Harmattan, 1997.
- MANNONI, P., Les représentations sociales. Paris : PUF, 2010
- MARCELLI, D., L’enfant chef de famille. L’autorité infantile. Paris : Albin Michel, 2003
- MARGUERAT, Y. & Poitou, D., À l’écoute des enfants de la rue en Afrique Noire. Paris : Fayard, 1994
- MASIALA, M.S., Les enfants de personne. Étude clinique et phénomène sociale sur l’enfance et la jeunesse défavorisée. Kinshasa : Enfance et paix, 1990
- MAYER, R. & OUELLET, F, Méthodologie de recherche pour les intervenants sociaux. Québec : Gaëtan Morin, 1991
- 14)MEULDERS KLEIN, Les recompositions familiales aujourd’hui. Paris : Nathan, 1993
V. ARTICLES
- KASEREKA MUYISA (J. C.) et BARAKA BUNANI (J. R.), « Le délai raisonnable devant le tribunal pour enfants de Goma », in Revue de la Recherche Juridique et politique (RRJP), novembredécembre 2022.
- CRÉGUT (F.), « L’approche restauratrice dans la justice juvénile », in Justice juvénile : les fondamentaux.
- BICDE, Recueil sur la justice pour enfants en République démocratique du Congo, 2ème édition, Kinshasa, 2018.
- DE NAUW, « Chronique semestrielle de jurisprudence », in R.D.P.C., 2004 ;
- H. SCHULTZ, « L’orientation moderne des notions d’auteur de l’infraction et de participation », in R.I.D.P., 1957 ;
- MARGUERAT, Yves, Enfants et jeunes de la rue : le processus de l’exclusion, Les cahiers de Marjuvia, n° 4, 1997, pp. 75-77.
- MARGUERAT, Yves, Rue sans issue. Réflexion sur le devenir spontané des enfants de la rue, Les Cahiers de Marjuvia, n°5, pp. 84-91, 1997
- MARGUERAT, Yves, Les chemins qui mènent à la rue. Un essai de synthèse sur le processus de production d’enfants de la rue en Afrique noire, Les Cahiers de Marjuvia, n° 9, pp. 45-58, 1999.
- BALAKIBALI Kokou Paka, problématique de la protection d’enfants soldats : cas de le République de Cote d’ivoire, du Libéria et de la République Démocratique du Congo, mémoire de recherche, 2004-2005, Nantes, CODES.
- BUGNION, F., Les enfants soldats, le droit international humanitaire et la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, in Revue africaine de droit international et comparé, , n°2, Juin 2000
- J. LARGUIER, « Chronique de jurisprudence », in R.S.C., 1979 ;
- LAPIKA DIMOMFU, B., La sorcellerie des enfants à Kinshasa : une approche anthropo-épistémologique. Rapport final, juillet 2007, inédit.
- LARIVAILLE, P., L’analyse (morpho) logique du récit, Poétique (19), 1974.
- Lebovici, S. (s.d.). Aperçu des recherches sur la notion de carence maternelle. 15)Lucchini, R. (s.d.). Présentation du texte 3 : le départ dans la rue de R. Lucchini, note de cours. Université de Fribourg. Fribourg. En lignewww.unifr.ch/socsem/cours/compte…/exposé%20E%20rue30%2 0nov.pdf
- NGUB’USIM MPEY NKA, La récupération des jeunes de la rue par une éducation au travail productif, Zaïre-Afrique, n°269, pp. 537-544, 1992.
- PARAZELLI, Michel, Etre jeune aujourd’hui, Nouvelles pratiques sociales, vol. 2, n°2, 1989.Disponible en ligne : http://id.erudit.org/iderudit/301059ar
- PETITCLERC, Jean-Marie, Pratiquer la médiation sociale. Un nouveau métier de la ville service dulien social, Paris, Dunod, 2002
VI. THESES, D.E.A ET RAPPORTS
- AZIA DIMBU L., F. Enfants de la rue. Enfants d’avenir. Une étude psychologique du phénomène à Kinshasa par une approche projective. Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation non publiée, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, 2009.
- MBWAKA, M.J. Image de soi et anticipations imaginatives des rôles chez les enfants des rues de Kinshasa. Thèse de doctorat en psychologie non publiée, Université de Kinshasa. Kinshasa, 2005.
- MERZOUKI HOURIA, Étude de la relation familiale chez l’enfant victime de la maltraitance parentale. Thèse de doctorat en psychologie non publiée, Université Mentouri. Constantine, (2005, En ligne bu.umc.edu.dz/theses/psychologie/MER873.pdf
- NYABIRUNGU mwene SONGA, « La faute punissable dans les infractions routières, Etude de droit comparé », Thèse de Doctorat, Louvain-la-Neuve, 1980 ;
- KIENGE KIENGE, R. Le contrôle policier de la «délinquance» des jeunes à Kinshasa : une approche ethnographique en criminologie. Thèse de doctorat en criminologie publiée, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2005.
- KASONGO LUKOJI Ghislain, « Essai sur la construction d’un droit pénal des mineurs en R.D. Congo à la lumière du droit comparé », Thèse de Doctorat en Droit, Université d’Aix-Marseille, 2017 ;
- La coalition pour mettre fin de l’utilisation d’enfants soldats, enfants soldats, rapport mondial 2004,
- AMNESTY INTERNATIONAL, rapport portant ´ enfants en guerre, septembre 2003
- UNICEF, la Situation des enfants dans le monde, New York, Unicef, 2005
- UNICEF, Action humanitaire de l’Unicef Rapport 2009 disponible sur www.unicef.org/har
- OCDE, Perspectives Èconomique en Afrique, Rapport 2005-2006, RDC, doc BAFD/2006, pp. 244-245 disponible sur www.oecd.org/dev/
- RDC, Rapport national sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, Kinshasa, 2004.
- UNICEF, Rapport MICS, Bruxelles, 2006
- UNICEF, Enquîtes nationale sur la situation des enfants et des femmes, Rapports MICS2, 2001
- Comité DESC, Observation générale n° 1 4 : Le droit au meilleur Etat de santé susceptible d’être atteint, documents officiels du Conseil Economique et social, 2000, E/C.1 2/2000/4,.
- UNICEF, La situation des enfants dans le monde ; Les enfants dans un monde urbain, 2012
- USAID EDB, Étude de la situation de référence des structures d’accueil, des structures de formation, des daaras, des enfants de la rue, des talibés, des associations de maîtres coraniques et d’autres acteurs pour les régions de Dakar, Louga, Saint-Louis et Matam, 2010,
VII. WEBOGRAPHIE
- Kibwenge, F. (mai 2009). Évangélisation et attentes du salut en contexte africain. En ligne www.sedosmission.org/site/index.php?option=com_docman
- Lucchini, R. (s.d.). Présentation du texte 3 : le départ dans la rue de R. Lucchini. (pp.1-9) note de cours, Université de Fribourg, En lignewww.unifr.ch/socsem/cours/compte…/exposé%20E%20rue
- Kibwenge, F. (mai 2009). Évangélisation et attentes du salut en contexte africain. En ligne www.sedosmission.org/site/index.php?option=com_docman
Me CIALU SION
Avocat près la Cour d’Appel du Haut-Katanga, République Démocratique du Congo
+243 999496547 / sionmuteba67@gmail.com